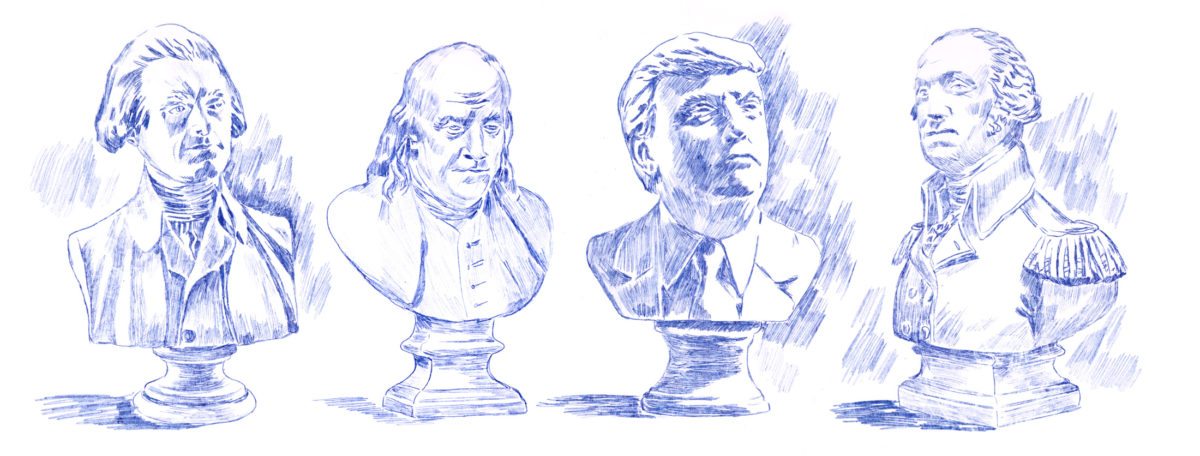Serait-ce un grand malentendu ? Ou n’avons-nous rien compris ? Que peut-on encore mettre derrière le terme « démocratie » alors qu’il est récupéré par l’extrême droite, qu’il n’est plus reconnu par une certaine frange de la population, voire qu’il est utilisé comme prétexte pour dominer ? Le professeur de sciences politiques Francis Dupuis-Déri (Université du Québec à Montréal) retrace l’histoire des deux « démocraties » que sont la France et les États-Unis et révèle que leurs « Pères fondateurs » étaient loin d’être démocrates ! Alors que la démocratie est globalement assimilée au régime électoral et que l’expérience de tout pouvoir populaire se heurte toujours aujourd’hui au mépris des élites, l’auteur nous emmène dans les méandres de l’histoire pour nous ramener au 21e siècle et offrir des clés de compréhension pour développer une pensée critique de la démocratie.
Nous apprenons, en lisant votre ouvrage, que le terme « démocratie » n’a pas toujours été vu de manière positive. Cela parait paradoxal, à l’heure où elle est vantée partout…
Ce fut la motivation première de ce projet. C’est en découvrant des écrits d’historien·nes, des textes d’archives sur l’époque de la Révolution française et de la Guerre d’indépendance aux États-Unis où le mot « démocratie » n’était soit pas utilisé, soit employé de manière péjorative, que je me suis questionné. Ceux qu’on qualifie de « Pères fondateurs » ne disaient jamais qu’ils voulaient fonder une démocratie. C’est l’énigme que j’ai voulu résoudre. Si on dit aujourd’hui de ces pays que ce sont des démocraties, quand la transformation au niveau du vocabulaire s’est-elle produite ? Car oui, les régimes qu’on appelle aujourd’hui des démocraties ont été fondés par des personnes qui n’étaient pas démocrates et qui ne prétendaient pas l’être. Ils avaient reçu une éducation classique, gréco-romaine, certains lisaient un peu ou beaucoup le latin ou le grec ancien. Leur conception de la vie politique ou de l’histoire politique, c’était celle d’Athènes et de Rome. Et dans cette histoire-là, ils se voyaient comme les descendants ou les héritiers de la République romaine, jamais de la démocratie athénienne. Car cette dernière représentait pour eux un échec, un régime problématique, le gouvernement des pauvres, le chaos, l’inefficacité, tout ce qu’ils ne voulaient pas.
C’est pour cela que vous avez créé le néologisme d’ « agoraphobie politique » ?
J’ai développé les concepts d’agoraphobie politique et d’agoraphilie politique parce qu’en rédigeant ce livre, je me suis retrouvé avec un problème d’auteur. Comme j’étudiais l’histoire d’un mot qui allait changer de sens au fil des pages, je ne savais plus comment utiliser le mot « antidémocrate »… Si je l’utilisais dans la première séquence, il ne voulait plus dire la même chose dans la deuxième. J’ai donc cherché à forger un concept qui voulait spécifiquement dire ce que je voulais dire, à savoir la peur de la démocratie directe. C’est la peur de l’agora en tant qu’espace public où le peuple se réunit pour parler de politique, prendre des décisions, discuter des affaires communes, agir collectivement… L’agoraphobie politique, c’est donc le sentiment des leaders qui ont peur quand le peuple se rassemble. La thèse qui la sous-tend, c’est que le peuple est irrationnel et manipulable par les démagogues, que cela sème les graines de la guerre civile et de l’éclatement de la société et que donc, il faut des chefs pour gérer tout ça et éviter le chaos. À l’inverse, l’agoraphilie politique rassemble les personnes qui aiment, ou veulent, qu’on ait des espaces pour se réunir et parler des affaires communes.
Ces dernières années, nous sommes envahi·es par des personnalités politiques réactionnaires. On pense à Trump évidemment, mais il y en a également de plus en plus en Europe. Est-ce qu’on peut dire de ces personnalités politiques qu’elles sont agoraphobes ?
Ce sont ce qu’on appelle des leaders populistes. Ils et elles ne disent pas avoir peur du peuple et prétendent au contraire que le peuple a été trahi. Mais selon moi, iels sont évidemment agoraphobes puisque ce qu’iels veulent, c’est le pouvoir. Et celleux qui veulent le pouvoir ne sont pas pour que les gens s’autogèrent collectivement dans le cadre de grandes agoras. Néanmoins, il y a du côté de la droite conservatrice et de l’extrême droite cette tradition à masquer leur jeu en affirmant qu’elles veulent défendre les « vrais » intérêts du « vrai » peuple. Les leaders de ces partis promettent par exemple souvent de mettre en place des initiatives citoyennes, des référendums, etc. pour redonner un peu de pouvoir à la population, mais une population nationale, évidemment, ce qui exclut finalement pas mal de monde. Et surtout, ils le font rarement quand ils arrivent au pouvoir.
Aujourd’hui, on utilise le terme « démocratie » un peu à toutes les sauces, c’est devenu un terme fourre-tout. Est-ce qu’on peut encore y croire ? Quel autre mot pourrait-on utiliser ?
Le mot « démocratie » est non seulement utilisé par tout le monde ou à peu près, mais en plus, il se décline avec une infinité de qualificatifs. Il y a la démocratie participative, électorale, libérale, représentative et toutes sont à peu près synonymes. Mais il y a aussi la démocratie de marché, la démocratie des consommateur·ices, etc. Tout devient démocratique. Et évidemment, cela dilue le sens et rend les choses plus confuses plutôt que de les préciser. Et surtout, une grande partie de ces choses désignées par ces concepts ne sont pas démocratiques du tout. Il y a une espèce d’illusion puisque le terme renvoie presque toujours à du positif. Accoler le mot « démocratie » un peu partout, c’est devenu une sorte d’argument marketing.
C’est devenu un produit que l’on vend ?
Oui, comme la liberté ! Les banques nous vendent la liberté, les compagnies d’assurance nous vendent la liberté, les partis d’extrême droite nous disent qu’ils vont défendre la liberté individuelle. Tout le monde nous vend la liberté, mais après ça…
Comment peut-on sortir de l’écueil d’un terme qui est totalement galvaudé aujourd’hui. Est-ce qu’il s’agit d’imaginer de nouveaux mots ?
Premièrement, moi, je n’utilise pas le mot « démocratie » pour parler de nos régimes. J’utilise soit « régime électoral » soit « régime parlementaire », je pense que c’est plus précis. Mais quand j’ai le temps de l’expliquer, je reviens à la tradition, complètement oubliée et pourtant très longue, d’Aristote, Rousseau, Montesquieu et de toute cette bande, laquelle affirme que quand il y a une petite minorité qui gouverne en étant élue, on doit parler d’ « aristocratie élective ». Je suis d’accord avec ça pour plusieurs raisons.
Tout d’abord pour une raison philosophique. Dans l’histoire de la philosophie politique, les philosophes qualifient les régimes électoraux d’aristocratie élective. Il me parait cohérent de suivre cette tradition. Rousseau explique qu’il faut distinguer différentes sortes d’aristocraties. Il évoque l’aristocratie héréditaire, qui est celle à laquelle on pense quand on pense au Moyen-Âge ou à la noblesse, mais donc aussi l’aristocratie élective, quand la population élit des gens pour la gouverner plutôt que de se gouverner elle-même.
Mathématiquement, c’est une aristocratie aussi parce qu’on élit un tout petit groupe. Je ne sais pas ici combien il y a de personnes au Parlement, mais c’est 0,0000001 % de la population, ce qui est minuscule.
Mais l’autre raison, qui est plus longue et compliqué à expliquer, c’est que nos parlements nous viennent du Moyen-Âge alors qu’on nous enseigne que tout ça nous vient d’Athènes. En fait, il n’y a absolument aucun lien ni historique ni institutionnel, aucune filiation avec la Grèce antique ! Il s’agit d’une reconstruction opérée aux 18e et 19e siècles d’une histoire qui n’existe pas. Et qui, en plus, efface toutes les autres expériences démocratiques de la planète, ce qui est assez malheureux.
Sachant que nos parlements viennent historiquement du Moyen-Âge, qu’ils ont été créés vers les 12e et 13e siècles, j’affirme que les député·es ont remplacé les ducs et les grands seigneurs qui étaient appelés au parlement. Ces derniers y étaient convoqués par le roi, principalement pour régler des problèmes fiscaux. Moi, je dis souvent que les député·es d’aujourd’hui remplacent les grands seigneurs. Iels ne portent plus d’armure, mais les partis politiques d’aujourd’hui sont comme les grandes familles de l’époque. Ils ont leurs blasons, leurs couleurs, leurs logos, etc. Même le vocabulaire en est issu. Lors des élections, on nous montre des cartes électorales comme si c’était des champs de bataille, on nous parle de percées, de fiefs électoraux, c’est un langage guerrier médiéval. On joue avec cet imaginaire-là, mais en réalité, il fait écho à des choses réelles qui relèvent de la vieille histoire médiévale. C’est pour cette raison aussi qu’il faut parler d’aristocratie élective. L’hérédité a été remplacée par l’élection.
Par exemple, typiquement, en Belgique, on a voté maintenant il y a plus de 500 jours, et à Bruxelles, on n’a toujours pas de gouvernement. Comment peut-on encore dire qu’on est dans un régime électoral alors que cela dysfonctionne autant ?
Parce que nos administrations publiques, nos ministères et même nos grandes villes sont devenus des machines tellement énormes qu’elles fonctionnent sans les politicien·nes. On constate qu’il y a des changements de parti, mais on a quand même l’impression que c’est toujours un peu la même chose. D’ailleurs, même les partis qui disent qu’ils vont faire de grandes transformations, ils n’y arrivent pas. On parle d’inertie, de résistances inconscientes, mais c’est surtout la routine qui prend le dessus sur les tentatives de réforme puisqu’il y a aussi des intérêts à défendre. Et donc c’est sûr qu’un changement de ministre ne change pas quoi que ce soit. D’autant que ce n’est de toute façon pas lae ministre qui gère de manière effective le système d’éducation, le système de santé, la police, etc. À l’époque médiévale, les aristocrates et le roi ne géraient presque rien. Ils rendaient la haute justice, ils pendaient les paysans qui chassaient des lapins sur leurs terres, ils organisaient des bals, ils mariaient leurs filles et ils levaient les impôts. C’était la communauté qui gérait l’éducation, la santé, les pauvres, le travail, etc. L’État moderne a pris tellement de responsabilités dans nos vies, c’est incroyable. Est-ce qu’on se rend compte qu’il y a des ministères pour tout ? Un ministère de la jeunesse, un ministère des vieux, de la communication, des sports, des loisirs, de la diversité…Toute notre vie est régie par des ministères, c’est quand même impressionnant. Et donc quand il y a des moments de vacances comme une crise politique, des changements d’équipe ou des blocages au niveau des partis politiques, c’est logique que la machine continue quand même à fonctionner au quotidien.
Comment redonner confiance en une démocratie qui n’existe pas ?
J’en reviens à l’aristocratie élective. On peut être pour ! Il y a toujours eu des gens qui ont appuyé les aristocrates ou les rois, sinon ils ne régneraient pas ! Quand il y a des guerres civiles ou des révolutions, il y a un monde fou qui se fait tuer et qui tue pour défendre le roi et les élites, que ce soit pour des questions de principes, d’intérêts, de stabilité, de patronage, etc. Il y a plein de raisons qui poussent un certain nombre de personnes à appuyer et à croire au système parlementaire.
Premièrement parce que beaucoup de monde pense que c’est la seule chose possible. Ces gens n’ont aucune idée de comment cela pourrait marcher autrement, iels sont né·es là-dedans et vont mourir là-dedans. Et puis on ne leur raconte que des histoires d’horreur, l’URSS, le nazisme, ce genre de choses, pour qu’au final, on se dise que tout ça est l’état naturel des choses de la civilisation avancée. Il faut bien réaliser que les gens mettent vraiment de l’espoir dans les mains de ces politicien·nes, iels pensent vraiment qu’iels vont faire les choses mieux que les autres. J’avoue que je ne sais pas pourquoi, mais apparemment les gens pensent ça. Le système est fort parce qu’on est socialisé·es pour y croire.
Quelles autres voies possibles que cette aristocratie électorale ? Quelles perspectives permettraient de redonner la parole aux premier·es concerné·es que sont les citoyen·nes ?
Je ne suis pas quelqu’un de très optimiste. Je n’arrive pas à visualiser une transformation radicale du système. Ce que je comprends des grandes crises, des grands renversements de régime, des grands moments où il y a des points de rupture, c’est que c’est rarement le résultat d’une stratégie concertée. Et contrairement aux visions très romantico-révolutionnaires, ce n’est généralement pas très drôle, c’est même très douloureux. Et ce sont les bons qui perdent. Bref, moi, je n’attends pas la révolution avec impatience, notamment parce que là où je suis, en Amérique du Nord, elle est attendue depuis longtemps et n’est jamais arrivée. Et puis il n’en faut pas beaucoup pour que l’État commence à tuer des gens. Le jour où il y aurait vraiment un mouvement révolutionnaire pour une démocratie directe où on se débarrasserait des élites et tout, ce serait vraiment un bain de sang et il n’est c’est pas sûr que les bons gagnent.
Ma deuxième réponse, et qui découle de ça, c’est que je pense qu’il faut, dans la mesure du possible, pratiquer nos idéaux politiques là où on est. Cela revient toujours à la même chose et à ce que je disais un peu tout à l’heure, à savoir que cela existe déjà de toute façon, dans des groupes citoyens, dans des groupes militants, dans des groupes politiques, dans des organisations d’entraide, dans des organisations solidaires. Ça me fait penser à une idée développée par Carole Pateman, une philosophe politique britannique qui enseigne en Californie, dans son livre Participation and Democratic Theory. Celle-ci évoque le fait que cela n’a pas de sens de prétendre vivre en démocratie alors qu’on passe 40 heures par semaine (la majorité de notre temps éveillé) au travail. C’est-à-dire dans un lieu contrôlé par un patron qu’on ne peut pas élire (et donc se présenter contre lui) et qui empoche les revenus. Quelqu’un qui va décider de comment et sur quoi ses employé·es travaillent, parfois même des vêtements qu’iels doivent porter, du moment où iels peuvent aller aux toilettes, etc. Comment peut-on penser qu’une population soumise à ce régime au niveau économique soit en démocratie ? Elle revient donc sur les expériences de démocratie directe au travail, ce que l’on nomme l’autogestion, un mode de fonctionnement qui permet aux personnes qui y travaillent de décider collectivement des meilleures manières de fonctionner.