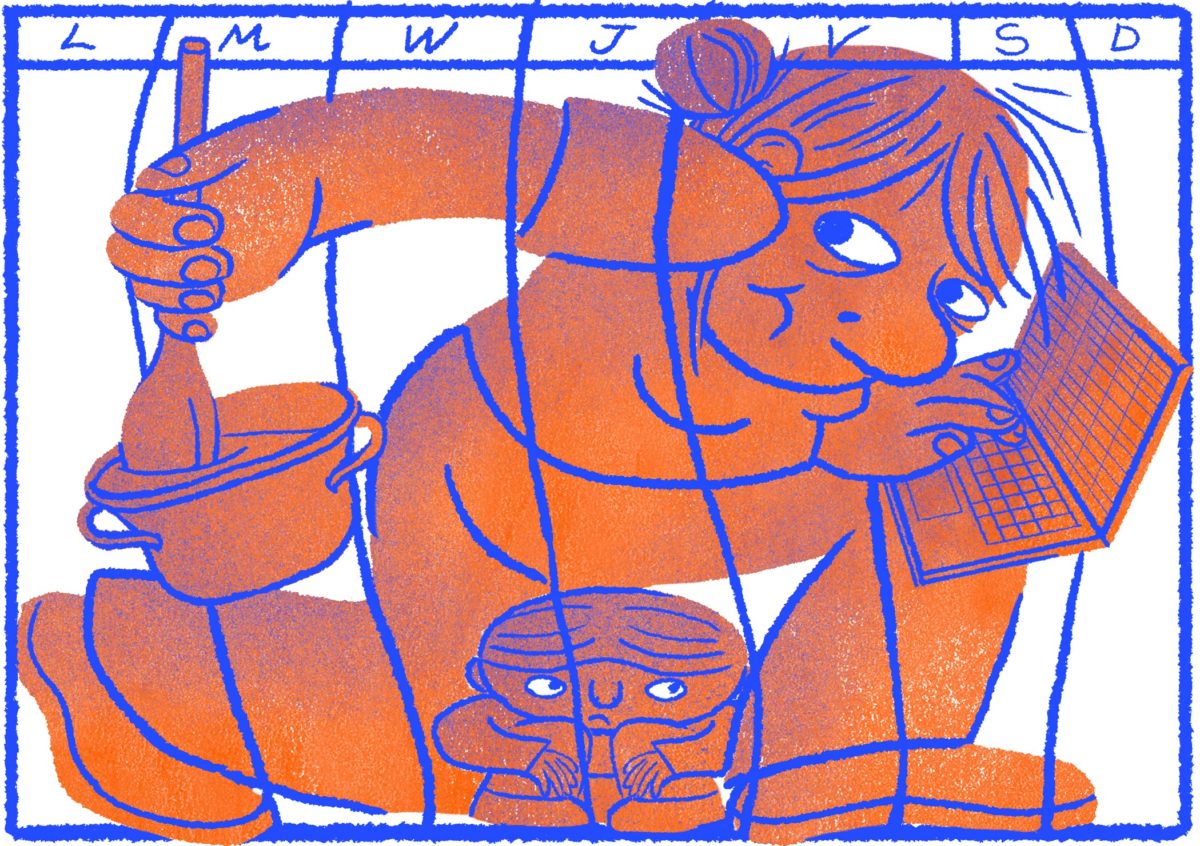À présent que le gouvernement De Wever est formé, de nombreuses mesures de flexibilisation dommageables aux conditions de travail et à la santé des travailleur·euses ont été entérinées dans l’accord de gouvernement, confirmant toutes les craintes du mouvement social qui avait suivi les négociations. Si l’ensemble des travailleur·euses vont être impacté·es par ces mesures antisociales, les femmes et les personnes minorisées le seront bien davantage que les hommes. Une analyse genrée du programme gouvernemental nous semble dès lors essentielle pour faire ressortir l’aspect profondément inégalitaire de ce train de mesures touchant au temps de travail.
L’article La f·r·acture sociale de la flexibilité paru en décembre dernier mettait en lumière des projets de mesures qui se discutaient alors dans le cadre des négociations en vue de la formation du gouvernement. Sur base de la « super nota » qui circulait alors, les inquiétudes étaient déjà grandes pour son auteur, Andrea Della Vecchia, secrétaire fédéral de la FGTB, sur les conséquences du projet visant à davantage de flexibilité du temps de travail. Si les plus optimistes d’entre nous espéraient que ces dispositions disparaitraient de l’accord de gouvernement qui serait acté, iels en sont pour leurs frais puisque le projet se voit entériné quasi tel quel dans le programme détaillé qui va guider les politiques nationales des prochaines années.
L’analyse d’Andrea della Vecchia avait montré à quel point ces dispositions vont être dommageables pour tous·tes. Mais, au vu de la nature et de l’ancrage « de facto anti-femmes »1 de ce gouvernement, nous essayerons ici de voir en quoi ce train de mesures antisociales impactera plus fortement les femmes2 que les hommes. Deux points précis de l’accord gouvernemental nous semblent particulièrement essentiels à analyser avec un regard genré. Celui concernant l’annualisation du temps de travail d’une part, et celui relatif au travail de nuit d’autre part.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le premier point de l’accord, situé à la page 18 du document d’accord gouvernemental, concerne l’annualisation du temps de travail. Le voici in extenso : « Après concertation avec les partenaires sociaux, un nouveau cadre légal sera introduit avant le 30/06/2025, permettant l’annualisation du temps de travail ou des horaires ’accordéon’ pour les emplois à temps partiel et à temps plein. Cette annualisation sera mise en place sous réserve de l’accord des employés concernés, sans perte de pouvoir d’achat et avec le choix libre entre récupération du temps de travail ou paiement. Lorsque cela est possible, un système d’enregistrement du temps de travail sera mis en place ».
L’annualisation est une forme de modulation du temps de travail et de fluctuation du nombre d’heures hebdomadaires travaillées réparties sur une année. Concrètement, cela signifie que l’on ne raisonne plus en heures travaillées par semaine, mais que les heures sont réparties sur les douze mois de l’année de manière globale. Ce régime constitue un gros avantage pour l’employeur·euse qui peut ainsi déroger aux fameuses 38 heures de travail par semaine en fonction de la variation des activités, et donc des besoins de son entreprise. Ainsi, iel peut éviter d’avoir recours aux heures supplémentaires qui lui coûtent bien plus cher et éviter le passage de certain·es de ses employé·es au chômage partiel lors des périodes creuses. Ou encore d’éviter de devoir faire appel à des intérimaires lors des phases plus denses.
Alors qu’aujourd’hui, un·e employé·e à temps partiel peut accepter de prester des heures supplémentaires lorsqu’il y a davantage de travail en bénéficiant alors d’un salaire plus élevé, l’annualisation du temps de travail annule cette possibilité puisque l’employé·e qui travaillera plus à un moment donné travaillera ensuite moins plus tard et ainsi aura presté le même nombre d’heures sur l’année. Les travailleur·euses perdent toute autonomie concernant leur temps de travail, ainsi que leurs horaires.
Si cette disposition impacte l’ensemble des travailleur·euses, elle touche encore davantage les femmes pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu’elle concerne des secteurs d’activité qui emploient majoritairement des femmes. Comme le souligne La Ligue des Familles dans leur analyse de l’accord : « Avec la réforme, une personne travaillant dans la grande distribution pourra être amenée à travailler 50 heures par semaine en décembre pour répondre à l’affluence liée aux fêtes de fin d’année, mais seulement 20 heures par semaine en mars, lorsque l’activité est plus calme. (…) Par exemple, une réceptionniste à mi-temps pourra travailler 12 heures pendant une semaine calme, puis 28 heures la semaine suivante pour couvrir un événement organisé par son entreprise. (…) Or, quelle que soit la période de l’année, les horaires des garderies scolaires, les horaires de repas et de coucher des enfants, etc. ne changent pas ». Or, il est avéré que toutes ces charges familiales sont principalement portées par les femmes, et que ce sont elles qui, lorsque cela s’avère nécessaire faute de soutiens familiaux ou de marge de négociation avec leur employeur·euse, finissent par rester à la maison ou à passer à temps partiel.
TRAVAIL DE NUIT
Le second paragraphe sur lequel nous souhaitons mettre un point d’attention se trouve page 19 de l’accord gouvernemental : « L’interdiction du travail de nuit est supprimée. La réglementation en matière d’heures d’ouverture est assouplie. Pour redevenir compétitif par rapport à nos pays voisins dans le secteur de la distribution et des secteurs connexes (dont l’e‑commerce), le travail de nuit commence désormais à partir de minuit (24 heures) au lieu de la limite actuelle de 20 heures, sans perte de pouvoir d’achat pour le travailleur qui travaille déjà aujourd’hui entre 20h et 24h. Nous simplifions également les procédures ».
Cet élargissement des horaires de travail, ainsi que la possibilité d’une généralisation du travail dominical touchera principalement les secteurs du commerce et de la distribution, où les femmes sont majoritaires. Ces dernières seront donc directement impactées par la perte du sursalaire en vigueur aujourd’hui pour ces temps travaillés hors des horaires traditionnels. En outre, une nouvelle fois, ce sont elles qui devront faire face aux conséquences familiales, puisque, si les horaires de travail sont élargis, ceux des espaces de garde d’enfants, notamment, ne le seront pas.
Pour la Ligue des Familles qui a également pointé ce passage dans son analyse de l’accord : « Ces modifications prévues au droit du travail engendreront un accroissement des horaires de travail incompatibles avec la vie de famille. Cela compliquera l’organisation familiale voire empêchera certains parents – en particulier les familles monoparentales3, mais aussi ceux dont les conjoints travaillent déjà à ces horaires – de continuer à travailler ou d’accéder à l’emploi. On flexibilise le droit du travail, mais les besoins et les horaires des enfants, eux, ne sont pas flexibles ». En soulignant que les familles monoparentales sont majoritairement , il apparaît évident que l’impact sur les femmes pourra s’avérer très violent puisqu’elles ne seront pas en mesure de faire face à cette flexibilisation accrue de leurs horaires.
LA FLEXIBILISATION JOUE SUR LA SANTÉ DES FEMMES
Toutes ces dispositions ne seront pas sans effet non plus sur la santé physique et mentale des femmes. Le travail en soirée et de nuit, notamment, nuit à la santé de toustes, mais certaines conséquences sont plus marquées chez les femmes que chez les hommes.
L’horloge biologique des travailleur·euses de nuit étant totalement déréglée, cela peut avoir des effets délétères sur les cycles hormonaux des femmes. Le travail nocturne perturbe la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, ce qui peut affecter le cycle menstruel et accroître le risque de troubles hormonaux. Ceux-ci peuvent constituer un terrain favorable à la croissance de cancers hormonodépendants et de cancers du sein. Le dérèglement hormonal peut également accentuer les symptômes vécus lors de la ménopause, tels que les troubles du sommeil et les bouffées de chaleur. Enfin, d’après une étude, il semblerait également que ces horaires atypiques puissent occasionner un risque accru de fausses couches.
La charge mentale qu’impose la flexibilisation du travail ainsi que le travail de nuit et les week-ends repose essentiellement sur les femmes et les mères monomarentales. La double journée de travail4 continue à leur incomber principalement, avec ses conséquences en termes de fatigue et de stress. Ces horaires impactent également directement la vie sociale, puisqu’ils imposent une vie en décalage constant avec la famille et les ami·es. Cela peut être un terrain favorable à la détresse psychologique et à une rupture avec les proches, entraînant un isolement pour les femmes qui ont en charge leur famille en sus de leur travail de nuit ou en dehors des horaires conventionnels.
Qu’il s’agisse de l’annualisation ou de l’élargissement des horaires de travail, les femmes vont être durement touchées. Et cela sans compter d’autres mesures de l’accord gouvernemental concernant les pensions ou encore les congés parentaux qui sont particulièrement inquiétantes.
Comme le résume Vie Féminine, ce gouvernement (dont le non-respect total en matière de parité femme-homme est patent et révélateur) place les femmes « en première ligne des mesures socio-économiques drastiques que le boys club de la rue de la Loi entend prendre ». Et le mouvement féministe de s’alarmer « de l’effet des politiques annoncées sur la situation des femmes, déjà statistiquement plus précaires que les hommes. Lorsqu’on affaiblit leur autonomie économique, c’est bien aux droits des femmes que l’on s’attaque ».Fe
Certes, certaines de ces dispositions doivent encore faire l’objet de négociations avec les syndicats dont nous pouvons espérer qu’ils joueront leur rôle de contre-pouvoir et être entendus pour un mieux-être de toustes les travailleureuses, et donc aussi des femmes. Mais c’est aussi l’ensemble des militant·es et mouvements progressistes et féministes qui doivent s’alarmer de ces mesures socioéconomiques et se mobiliser contre leur adoption au nom des droits des femmes.
- Comme le pointe le mouvement féministe belge Vie féminine dans son communiqué de presse suivant l’annonce de nouveau gouvernement
- Nous utilisons le terme « femme » à divers endroits dans ce texte lorsque nos sources renvoient aux personnes qui se définissent comme telles. Il est néanmoins évident que l’ensemble des personnes FINTA (femmes, intersexes, non binaires, trans et agenres) et des populations minorisées se retrouveront autant impactées par ces mesures gouvernementales, mais certains textes qui ont nourri notre analyse, ainsi que la note gouvernementale, gardent encore une certaine vision binaire de notre société.
- Le terme communément admis de foyer monoparental est de plus en plus questionné, sachant que la plupart d’entre eux sont constitués d’une mère et de son/ses enfants. Raison pour laquelle nous faisons le choix d’utiliser l’expression foyer monomarental, qui renvoie davantage à la réalité et qui contribue à la démasculinisation du langage.
- Répartition inégalitaire du travail domestique entre hommes et femmes qui contraint ces dernières, lorsqu’elles ont une activité professionnelle, à la cumuler avec la gestion ordinaire de la vie en couple et en famille (tâches ménagères, soutien des enfants, maintien du lien social, gestion de l’agenda, contraception, etc.). Définition issue de Les mots du contre-pouvoir. Petit dico féministe, antiraciste et militant, Academia, 2022.