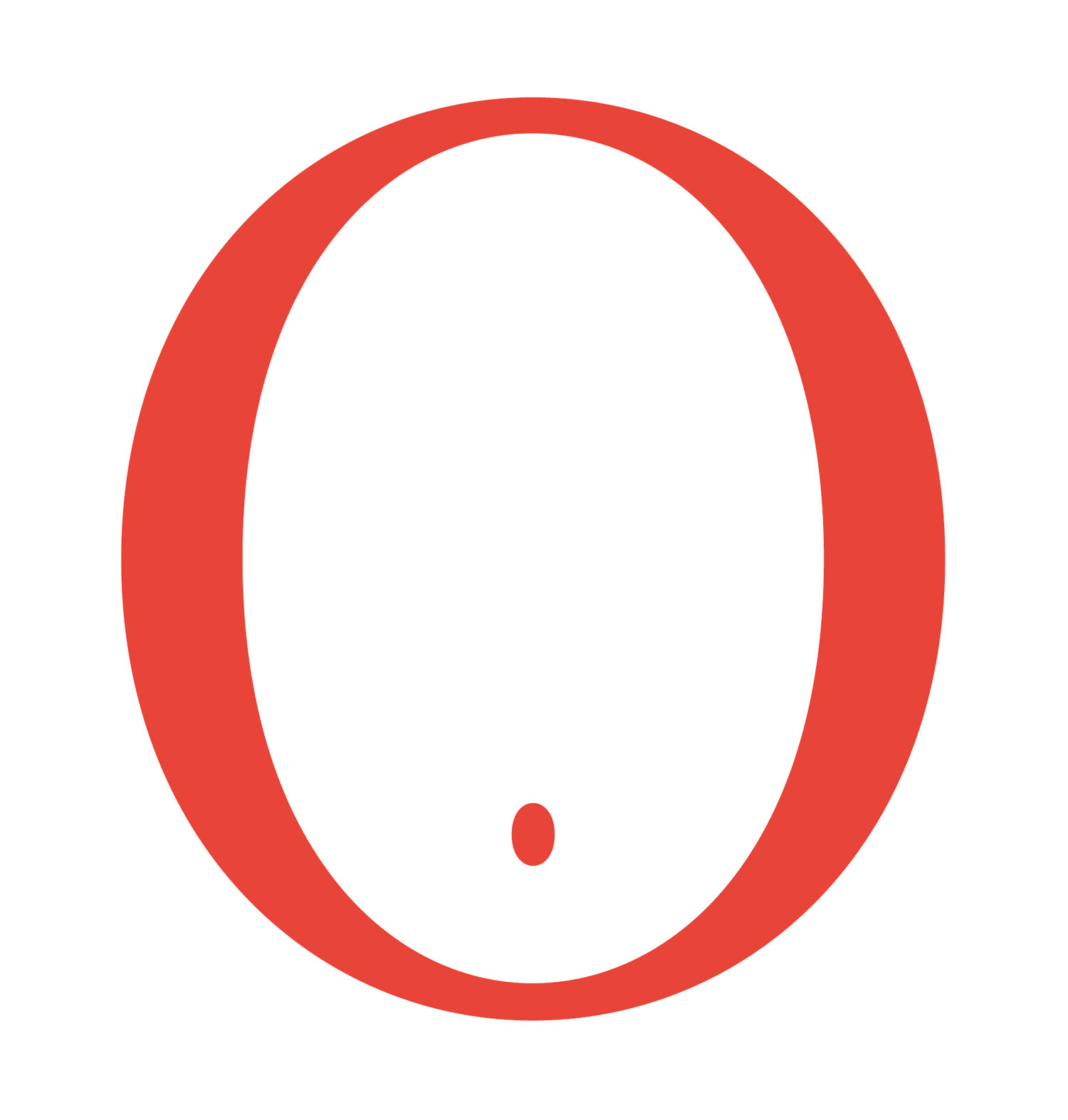Walking Dead, Resident Evil, World War Z… Les zombies envahissent nos écrans, consoles de jeux et bibliothèques. Il est vrai que les mythes fantastiques ont la peau dure, et celui du mort-vivant plus que tout autre. Parce qu’une fois effacée la frontière entre la vie et la mort, c’est à une autre image de nous-mêmes que nous sommes confrontés. Un double en putréfaction, mort et vivant à la fois, n’ayant qu’une obsession instinctive : dévorer nos corps. Condamnés, nous ne pouvons que nous défendre avec les moyens du bord et survivre dans un monde en voie de déshumanisation.
La saga des morts-vivants constitue la plus formidable arme critique du joyeux foutoir ultralibéral dans lequel beaucoup d’entre nous survivent déjà. Si le zombie crève l’écran après la crise de 29, avec des films comme White zombie (Victor Halperin, 1932) ou I Walked With A Zombie (Jacques Tourneur, 1943), c’est surtout avec le formidable Plague Of The Zombies de l’Anglais John Gilling que les choses deviennent réellement effrayantes. Classique des productions Hammer, ce film de 1965 est une vision radicale de l’industrialisation à la fin du XIXe siècle. Ici, le zombie c’est l’ouvrier manipulé et contraint de travailler dans des conditions extrêmes au profit d’un riche châtelain, adepte du vaudou. Le message du réalisateur est sans appel : les villageois ayant préféré se soumettre plutôt que de se révolter, ils disparaîtront eux aussi dans le grand incendie final qui emporte les moyens de production et leurs propriétaires.
L’Américain George A. Romero développera cette approche nihiliste tout en bouleversant les codes du genre. Chez lui, le zombie ne relève plus de la magie noire, il est le résultat d’une contamination sur laquelle le mystère restera toujours entier. Romero a consacré six films aux morts-vivants depuis son fondateur Night of the living Dead (1968), coup de gueule terrible contre la société ségrégationniste. Mais c’est avec Dawn of the Dead (communément appelé Zombie), dix ans plus tard, que Romero fait mouche avec une critique jouissive de la société de consommation. Retranchée dans un gigantesque complexe commercial, une poignée de rescapés s’organisent pour survivre dans ce temple abandonné du consumérisme. Dehors, malgré leur absence totale de facultés cognitives, les zombies se mettent à reproduire les gestes et habitudes de leur vie d’avant. Et se dirigent tout naturellement, en masse, vers le centre commercial… Superbe plan que ces corps animés errant sur de vastes parkings déserts, avant d’envahir une fois encore les allées des grandes surfaces.
Le monde d’aujourd’hui tient en ces quelques images et dans l’essentiel de la production zombiesque contemporaine. La métaphore est claire. Les zombies, c’est déjà nous. Nous dont l’imagination semble avoir abdiqué ; nous, adeptes d’une pensée molle et conditionnée, exercée sous l’œil vigilant et réducteur des médias de masse ; nous qui spolions nos espaces vitaux ; nous, tributaires d’une classe politique incapable de la moindre créativité.
Avant le générique de fin, une question demeure : est-ce qu’on mérite d’être sauvé ? (Diary Of The Dead, Romero, 2008).