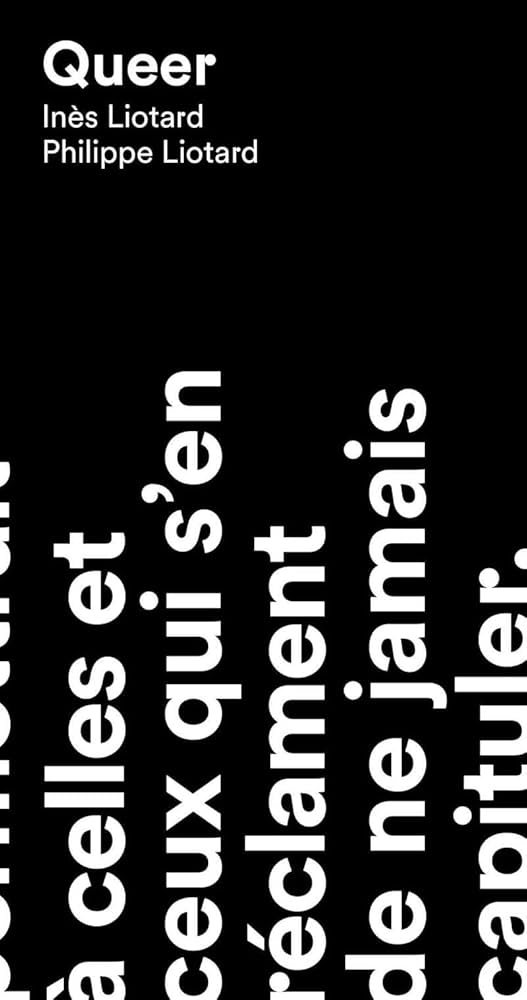
S’il est un mot dont on entend rarement, si ce n’est dans quelques sphères militantes, qu’il devrait être traduit, c’est bien le terme queer. Et pourtant, les anglicismes ont rarement la cote dans le monde francophone. D’ailleurs, sa définition aussi reste toujours floue, alors que nous vivons dans un monde normé à outrance. Mais n’est-ce pas justement là sa force ? Il file, il se dérobe, il s’invente et se réinvente au fil des époques et des luttes comme nous le racontent si clairement Inès et Philippe Liotard. Du retournement du stigmate à son origine à son caractère déviant revendiqué aujourd’hui, l’utopie sémantique reste son fondement. Par sa seule énonciation, il permet de définir, de se définir, mais aussi d’agir sur ce qui est comme un « mot manifeste » tel que les deux auteurices le qualifient. Et c’est justement parce qu’il n’est pas traduit, voire intraduisible, et peu définit, qu’il reste attractif pour toustes celleux qui sont à la marge des frontières du genre, mais aussi de la sexualité. Ce qu’iels nous explique, c’est que dans le monde francophone, queer participe à l’émergence d’une utopie sémantique. Qu’il permet de détourner les savoirs et les horizons tels qu’ils nous sont présentés et qu’il est efficace parce qu’il « contient et véhicule un triple potentiel de déconstruction des normes de genre, de sexualité et de savoir ». Il s’agit d’identité puisqu’il permet de décrire ce qui ne pouvait l’être grâce à aucun autre mot, mais aussi de politique puisqu’il propose un projet d’émancipation. En remettant en cause les fondements des normes et des savoirs, il offre un potentiel d’appropriation et de questionnement essentiel aux personnes qui s’inscrivent dans un processus de désidentification aux identités qualifiées de naturelles pour s’écarter des classifications établies. Mais aussi, et surtout, pour s’auto-identifier. Le terme queer dérange et fait peur puisqu’il dévie de la trajectoire rectiligne imposée par les dominants et intègre les avancées de luttes des minorités sexuelles et de genre tout en y associant les combats féministes, antiracistes et anticapitalistes. Il permet surtout à ces minorités de se dire et d’affirmer leur présence par-delà les codes tout en imposant, depuis leur point de vue situé, un questionnement, mais aussi de nouveaux savoirs et de nouvelles esthétiques.
July RobertQueer
Inès Liotard & Philippe Liotard
Anamosa, 2025
