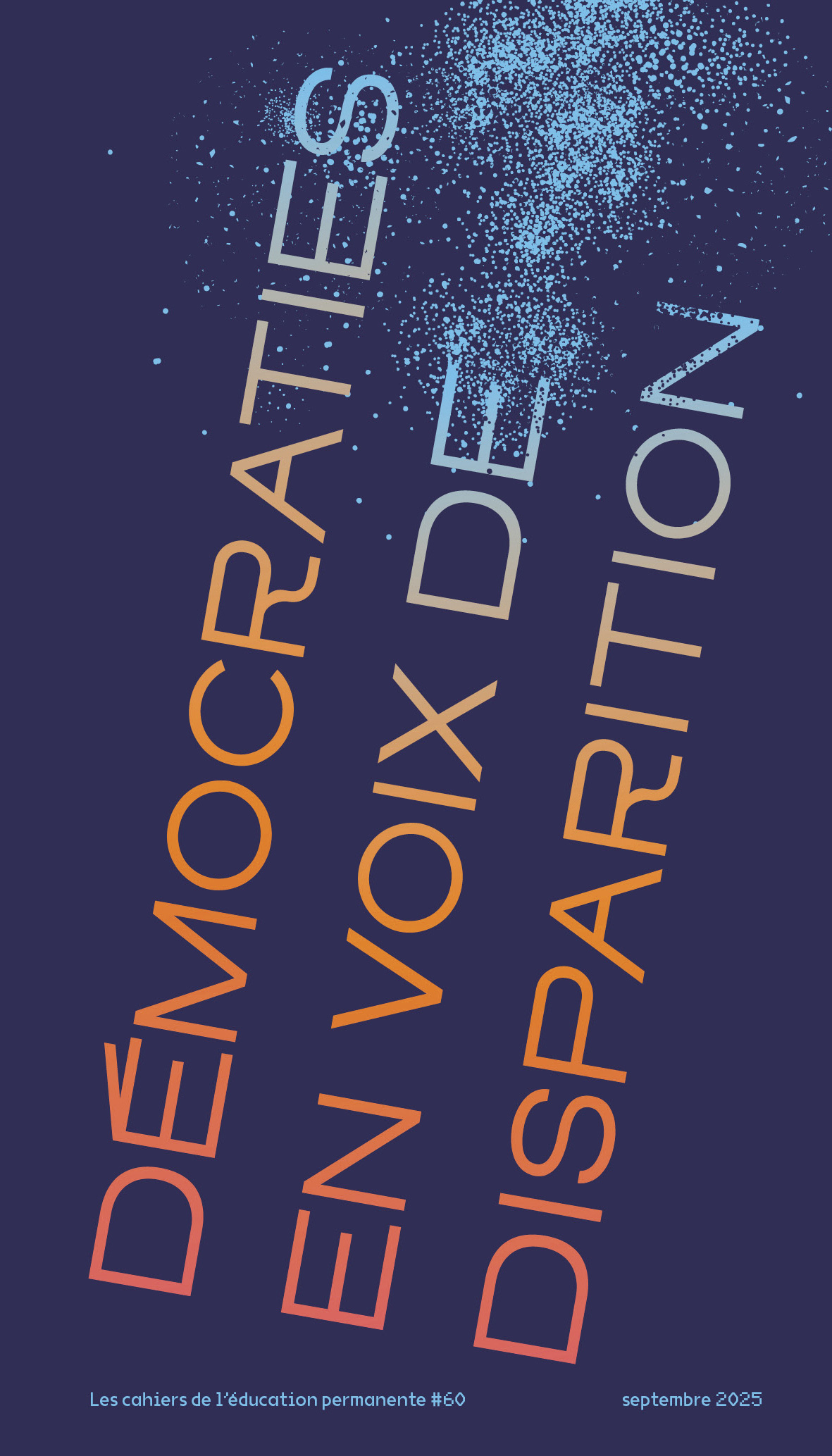Le dernier Cahier de l’éducation permanente « Démocraties en voix de disparition » tente de dresser des pistes visant à relier davantage les citoyen·nes aux processus de décisions politiques. Parmi les 11 intervenan·tes de cette étude, la chercheuse Caroline Sägesser qui dans « Rendre le goût du vote… » développe quelques idées pour restaurer la confiance dans la démocratie représentative et renforcer la démocratie participative. En voici quelques extraits.
Quelles solutions apporter ?
Les propositions fusent pour que les citoyen·nes retrouvent une influence sur le cours des choses.
En Belgique, c’est surtout la démocratie participative qui tient la corde pour impliquer davantage le·la citoyen·ne dans le processus décisionnel. En 2011, une expérience de démocratie délibérative largement médiatisée rassemble 1000 citoyen·nes tiré·es au sort pour réfléchir et formuler des recommandations à destination des représentant·es politiques, dans le contexte d’une crise politique d’une longueur alors sans précédent : après les élections du 13 juin 2010, il s’est avéré impossible de former un gouvernement fédéral. Il faudra attendre la conclusion de la sixième réforme de l’État pour permettre le 6 décembre 2011 au gouvernement di Rupo de voir le jour. L’expérience prend le nom de « G1000 », par référence contrastée aux sommets du G7 et autres G20 réunissant les dirigeant·es de ce monde. À la manœuvre, on trouve notamment l’historien flamand David Van Reybrouck, dont l’essai « Contre les élections » sera à l’époque largement diffusé, traduit et commenté. Pour lui, la démocratie représentative est dans une impasse. Pour l’en sortir, il préconise de recourir à ce principe démocratique de la Grèce classique, le tirage au sort.
Si le G1000 ne débouche pas sur des propositions renversantes, il démontre la faisabilité du concept et inspire la mise en place de mécanismes de représentation citoyenne permanente par le biais du tirage au sort. Le dispositif le plus abouti à ce jour est celui instauré par le Parlement de la Communauté germanophone en 2019. Il se compose d’un Conseil citoyen permanent (Bürgerrat) rassemblant des citoyen·nes tiré·es au sort, qui propose des sujets à examiner par l’assemblée parlementaire et qui peut également être consulté sur des questions spécifiques, ainsi que d’Assemblées citoyennes organisées pour délibérer sur des sujets spécifiques (Bürgerversammlungen). Depuis que le Conseil citoyen de la Communauté germanophone existe, sept groupes de citoyen·nes s’y sont succédé. Des Assemblées citoyennes ont été constituées pour débattre de sujets variés, comme la politique des seniors, les compétences numériques ou le logement. Elles ont débouché sur des recommandations qui ont été assez largement prises en compte par les décideur·euses politiques. La taille réduite de la Communauté germanophone, qui compte environ 80.000 habitant·es, permet à une proportion relativement élevée de citoyen·nes de participer aux processus délibératifs, ou à tout le moins de connaître personnellement un·e ou plusieurs citoyen·nes qui y sont impliqué·es.
Depuis 2021, des commissions délibératives auprès du Parlement bruxellois peuvent rassembler des citoyen·nes et des élu·es pour débattre de questions proposées par les citoyen·nes ou les parlementaires ; six d’entre elles ont déjà été organisées et ont formulé des recommandations. Au Parlement de Wallonie, une première commission délibérative initiée par le collectif citoyen Cap Démocratie, a adopté des recommandations pour développer l’implication permanente des Wallon·nes dans la prise de décision. Quant à la Chambre des Représentants, elle a adopté un dispositif permettant d’installer ce type de commission à l’avenir.
Contrairement aux craintes formulées par certain·es, le tirage au sort a démontré son efficacité pour mettre en place des assemblées représentatives de la diversité du corps social et pour susciter des délibérations approfondies permettant d’adopter des recommandations largement consensuelles. En revanche, il n’a pas encore démontré de façon convaincante sa capacité à infléchir significativement les décisions publiques, mais surtout, il n’a pas encore suffisamment montré qu’il contribuait à restaurer la confiance de l’ensemble de la population dans les processus démocratiques. Sans doute les participant·es aux diverses assemblées citoyennes en sortent-iels avec une confiance renouvelée dans les processus de décision politique auxquels iels ont été associé·es — si tant est que le politique tienne un minimum compte de ses recommandations. En revanche, la façon dont cette confiance renouvelée pourrait ruisseler sur la société tout entière n’est pas encore suffisamment réfléchie. Probablement dépend-t-elle fortement de l’échelle du territoire concerné par l’assemblée. À cet égard la petite Communauté germanophone constitue assurément un très bon terrain d’expérimentation.
Restaurer la confiance, une responsabilité des élu·es
D’autres mesures pourraient être envisagées pour augmenter la confiance des citoyen·es dans les mécanismes de la démocratie représentative. La suppression des listes de suppléant·es, là où elles existent encore (c’est-à-dire à l’élection des membres de la Chambre des représentants, des députés européens, des députés wallons et des députés flamands) , pour faire appel au·à la candidat·e non élu·e ayant obtenu le plus de voix en cas de désistement d’un·e mandataire donnerait plus de poids au vote des citoyen·nes au détriment du choix des partis. Il en va de même pour la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête, qui voit les voix du « pot commun » être distribuées aux candidat·es qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité dans l’ordre où le parti les a présenté·es au suffrage. Il est actuellement réduit de moitié pour la plupart des scrutins, et a été supprimé pour les élections provinciales ainsi que pour l’élection des conseiller·es communaux·ales en Wallonie (dans les communes de langue française) et dans toutes les communes de Flandre. La généralisation de cette suppression de l’effet dévolutif de la case de tête donnerait un poids plus élevé au vote de l’électeur·ice dans le choix des élu·es, tout en ayant pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales.
À propos des campagnes électorales, une régulation plus étroite des montants que les partis peuvent consacrer à la propagande en dehors des périodes de comptabilisation des dépenses, ainsi que des règles plus contraignantes de la dépense de la dotation généreuse qu’ils reçoivent seraient les bienvenues. Le financement public des partis politiques est en Belgique un des plus élevés de l’Union européenne, tant et si bien que les formations politiques en viennent à thésauriser une partie des montants reçus sous forme d’investissements immobiliers ou mobiliers. Par ailleurs, la dotation comprend une partie fixe modeste au regard de celle qui est mobile, et directement dépendante du nombre de voix récoltées par le parti lors de l’élection de la Chambre. Cette situation ne favorise pas l’accès des nouvelles formations à l’arène politique. En 2023, une série de recommandations ont été formulées par le panel citoyen, « We need to talk ». Hélas le monde politique , confronté à des suggestions de réforme de son mode de financement, à la fois juge et partie, a estimé préférable de ne rien faire, laissant les choses en l’état et les 60 citoyen·nes du panel fort dépité·es…
Naturellement, une démocratie représentative en bonne santé suppose des élu·es à la conduite irréprochable. S’il est légitime que les représentant·es de la Nation soient correctement rémunéré·es pour le travail important qu’ils accomplissent, leur rémunération se doit d’être transparente, et de ne pas être assortie d’avantages complémentaires, tels l’octroi d’allocations de frais forfaitaires défiscalisés, d’indemnités de sortie faramineuses ou de pensions supérieures aux plafonds admis
(…)
Soigner notre démocratie peut impliquer de lui greffer de nouveaux membres, sous forme d’un recours institutionnalisé aux processus délibératifs ou aux consultations populaires. Mais elle doit surtout consister à soigner son cœur, à savoir l’organisation de la représentation des citoyen·nes par des élu·es qui jouissent de leur confiance.