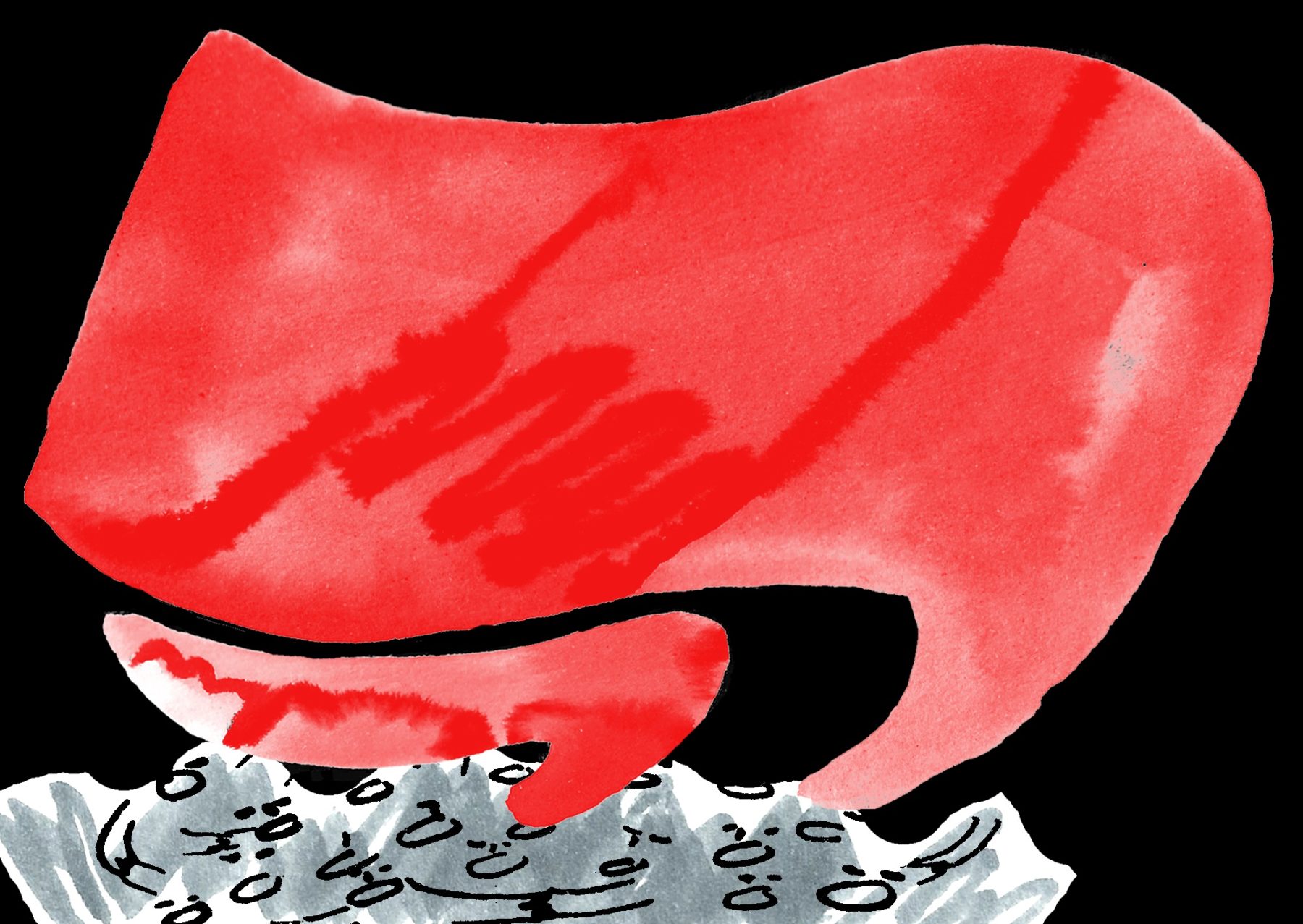Face à l’extrême droitisation de la droite belge francophone impulsée par George-Louis Bouchez, il nous faut directement préciser un premier aspect d’un imaginaire positif antifasciste. Au risque d’énoncer une évidence : on ne combat pas l’extrême droite en reprenant ses thématiques et en appliquant son programme. On ne peut mener une lutte antifasciste en reprenant la vision de la société de l’extrême droite car le projet antifasciste est son exact opposé. Il est donc indispensable, et c’est le travail fait par les collectifs s’assumant pleinement antifascistes jusque dans leur dénomination, de tenir fermement les positions face à l’adversaire et d’être intransigeants tant sur la forme que sur le fonds. Dénoncer partout et systématiquement, encore plus quand c’est dans le camp progressiste, les propos, idées et attitudes d’extrême droite. Empêcher, y compris physiquement, l’extrême droite de se réunir, d’occuper l’espace public, d’y apposer ses slogans et symboles… C’est une base. Mais malheureusement trop souvent négligée.
Battre la droite et changer la gauche pour changer nos vies
Porter un imaginaire positif antifasciste nécessite donc avant tout de cesser d’accepter les compromissions avec l’analyse biaisée de la situation que diffuse l’extrême droite depuis plus d’un demi-siècle dans sa volonté de (re)conquête idéologique. Mais il s’agit au contraire de développer un tout autre imaginaire basé sur une vision d’égalité construite socialement par la solidarité et la coopération et non pas sur une inégalité naturelle hiérarchisée et immuable. Cette vision ne peut être qu’anticapitaliste au sens où elle s’attaque à la propriété privée des moyens de production, à la captation des richesses par une minorité de plus en plus réduite et à l’exploitation jusqu’à épuisement des ressources de notre planète. Elle ne peut qu’être internationaliste, soit une solidarité entre les peuples souverains sur leur lieu de vie respectif. Elle est un universalisme qui n’est pas colonialiste mais acceptation et valorisation de la richesse des différences. En ce sens elle est forcément antiraciste car elle n’essentialise pas les comportements et modes de vie, elle accueille les personnes en exil sans jugement sur les raisons de ce dernier.
Ce modèle de société nécessite aussi un changement de pratique et de paradigme pour des formations politiques se qualifiant de gauche et/ou de progressiste. C’est acter que l’acceptation, depuis un demi-siècle par la social-démocratie, du fait qu’il n’y aurait pas d’alternatives en dehors du système économique capitaliste nous mène, au-delà d’une impasse, à une catastrophe. Cette acceptation a pour effet principal de ne plus donner une alternative à toutes les personnes, de plus en plus nombreuses, qui se retrouvent exclues ou qui ont peur de l’être. Elle a par ailleurs comme effet dévastateur que la gauche apparait comme ne réalisant pas ses promesses, à l’inverse de la droite et l’extrême droite qui font, ou donnent clairement l’impression de faire, ce qu’elles disent. Les paroles c’est bien, les actes c’est mieux. Et les gens ont besoin de voir des changements concrets sur leur quotidien.
L’abandon des classes populaires est la pire des fautes dont se sont rendus coupables les partis qui en étaient les représentants et les relais. D’autant plus quand, électoralement, ils sont prêts à nombre de concessions pour gouverner avec la droite plutôt que de tenter de construire des fronts populaires. Ce type de comportement renforce l’idée de l’électeur et électrice que les jeux sont faits d’avance, que tous les politiques « traditionnels » se valent… Le résultat n’est pas le déplacement massif vers la droite et l’extrême droite de l’électorat populaire mais sa désertion du champ politique.
Un imaginaire antifasciste passe donc par la réaffirmation de la conflictualité sociale et par la politisation des faits sociaux. Il passe par un discours clair sur le fait qu’une lutte des classes est bien toujours d’actualité et que ceux qui font sécession, ce sont les plus riches car ils ne veulent plus participer à un effort collectif et à la redistribution des richesses. Il passe par incarner et nommer les riches et ne pas laisser ce concept éthéré. Il faut désigner clairement qui ils sont, ce qui est d’autant plus facile que loin d’être invisibilisé comme les travailleuses et travailleurs qui produisent les richesses et permettent leur train de vie, les riches étalent leur mode de vie dans les magazines, les journaux, les reportages TV…
Répondre d’abord aux besoins matériels comme socle d’un développement intellectuel qui n’est pas négligé était bien ce que faisait le mouvement ouvrier du dernier quart du 19e à la première moitié du 20e. C’est en répondant à ce besoin premier qu’a été créée la sécurité sociale, base de la phase de prospérité qui a permis une émancipation intellectuelle et l’arrivée de nombreuses questions éthiques. Il n’est pas ici question d’abandonner ces dernières, mais de reconnaitre que leurs développement ne peut se faire alors que la précarité explose et que nombre de personnes sont dans des processus de survie. Se loger, se vêtir, se nourrir, avoir des loisirs, bouger… sont des besoins « primaires » qui pour beaucoup trop de personnes deviennent un horizon inatteignable.
Assurer cette sécurité première, faire des actions concrètes d’occupation d’immeubles, de régulation des prix des loyers, de distribution de nourriture, d’organisation de voyages même à courte distance… c’est rendre une perspective aux gens. Une perspective qui ne doit pas être rendue de manière philanthropique mais construite via des actions et des luttes de terrain impliquant, et donc politisant, les personnes concernées sur des enjeux au cœur de leur quotidien et préoccupations et qui peuvent aller jusqu’à des mobilisations contre les violences policières, le racisme systémique, la sécurisation des lieux de fêtes, la création et la gestion de lieux collectifs (dit « tiers lieux »)… Bref il s’agit pour paraphraser Marx que l’émancipation des personnes dominées soit l’œuvre des personnes dominé·es elles-mêmes. Et il y a de la joie, de la vie dans le fait de se mobiliser ensemble pour des projets que l’on porte. C’est aussi une manière de réenchanter nos luttes.
Outre la sécurité sociale, le service public, la première richesse de celles et ceux qui n’en n’ont pas, est à développer. Un service public pensé pour l’ensemble des personnes, et prioritairement pour les plus démunis et non dans une logique de travaux de prestige d’infrastructures destinées à ceux qui sont déjà aisés. Des points d’arrêt et des gares partout pour un maillage de transport public plutôt que des gares pharaoniques pour TGV. Des lignes de bus desservant les quartiers efficacement plutôt qu’une ligne de tram pour un centre-ville gentrifié, des bibliothèques et lieux culturels de quartier plutôt que des centres d’arts contemporains élitistes… La culture populaire n’est pas la culture abrutissante mais la culture faite avec les gens, expliquée aux gens, partant de ou faisant échos à leur réalité et non le nombril ou le miroir d’une classe bourgeoise égocentrée. En ce sens il faut en revenir à une éducation populaire, partant du vécu, des sujets, préoccupations et savoirs des gens et non une éducation permanente visant à leur expliquer ce qu’ils devraient penser. À nouveau il s’agit de faire « avec » et non « pour ».
À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités !
Cette injonction du début du mouvement émancipateur (qu’il soit socialiste, communiste, anarchiste…) reste clairement la base d’un horizon désirable. Elle est souvent détournée avec deux « à » ou deux « de ». Or elle est claire. On reçoit selon les besoins que l’on a et qui sont différents d’un individu à l’autre, d’une période de vie… et l’on participe selon des capacités physiques, intellectuelles, financières qui sont aussi différentes et peuvent évoluer. Cette perspective est une perspective d’action collective sur la gestion des communs, de ce qui fait société via la coopération et non la compétition. Elle ne dissout cependant pas l’individu dans un moule homogène mais au contraire reconnait l’hétérogénéité des situations et leurs apports complémentaires. Dans cette vision, toutes les activités utiles à la société sont valorisées de manière égale ou via des différences limitées acceptables et comprises par toutes et tous.
Une telle perspective oblige par ailleurs l’exercice plein de la citoyenneté, non pas comme un concept abstrait mais comme la participation de toutes et tous aux décisions les concernant. La démocratie n’est alors plus un concept désincarné et lointain auquel on est plus ou moins convié à participer tous les x temps via le don de sa voix, mais une réalité concrète appliquée (quasi) quotidiennement. Une implication qui nécessite de dégager du temps pour soi et pour la collectivité et non plus de se le voir aliéné. Et une démocratisation qui doit aussi s’étendre sur le lieu de travail ! En cela le développement de coopératives, d’entreprises en autogestion… sont des pistes à développer.
Et faisons un pari sur l’avenir et sur l’imaginaire : quand les gens participeront réellement aux décisions qui les concernent pensons-nous sérieusement qu’ils limiteraient les allocations de chômage dans le temps ? Qu’ils laisseraient flamber les prix de l’immobilier ? Qu’ils augmenteraient l’âge de la pension ? Qu’ils flexibiliseraient les conditions de travail ? Qu’ils pollueraient les sols ? Qu’ils maintiendraient la culture du viol ? Qu’ils laisseraient des gens mourir dans la rue ? Ou au contraire qu’ils rendraient les études réellement gratuites, développeraient l’accessibilité aux soins de santé, construiraient des infrastructures pensées avec et pour eux dans leurs quartiers, développeraient des transports en commun aux horaires et parcours adaptés à leurs besoins…
Construire un imaginaire antifasciste n’est pas écrire un roman utopique, c’est politiser les gens et construire avec eux les solutions concrètes à leurs besoins matériels et intellectuels. Ce n’est pas s’en remettre à une figure providentielle, mais acter que nous sommes toutes et tous une partie de la solution si nous coopérons pour la faire advenir. Ce texte ne prétend donc pas décrire tous les devenirs désirables possibles.
« L’appel des 250 », initié en mai 1990, après l’ignoble profanation antisémite du cimetière juif de Carpentras pour lutter contre le Front National disait de l’extrême droite que « ses avancées sont faites de nos reculs ». Clairement faisons en sorte que nos conquêtes les fassent reculer.
L'auteur : Julien Dohet, Coordination Antifasciste de Belgique