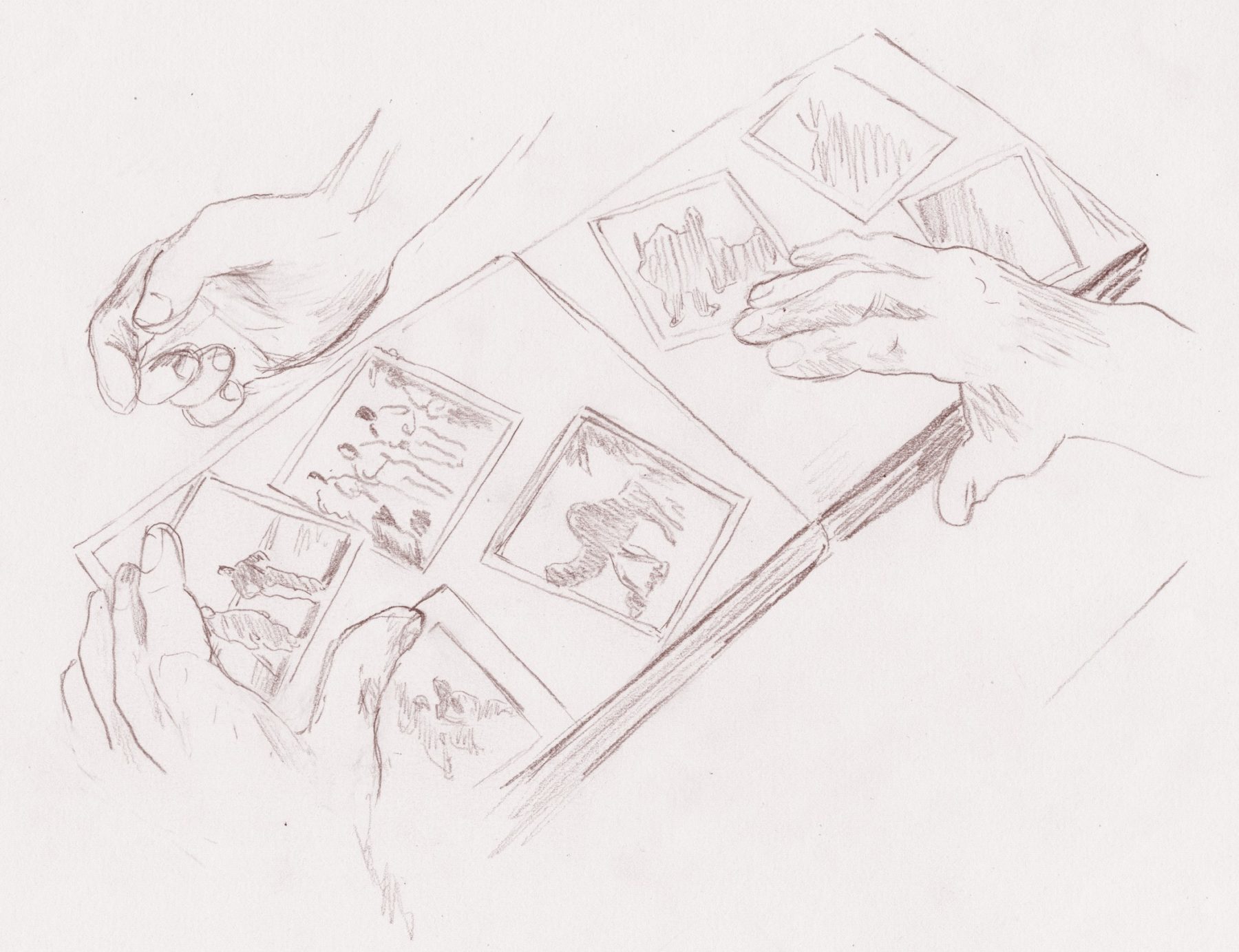Si la psychanalyste Karima Lazali s’interroge, dans son ouvrage Le trauma colonial1 en ces termes « Comment élaborer son histoire personnelle lorsque le silence parental rejoint le blanc du politique ? Tout est mis en place en France et en Algérie pour assurer l’impunité de la colonialité », Dorothée*Myriam Kellou se questionne quant à elle ainsi : « Où ma mémoire est-elle défaillante ? Partout j’ai la sensation d’un effacement, d’une disparition dont il me resterait néanmoins des indices ». Ces indices, elle en a fait un film À Mansourah tu nous as séparés, un podcast L’Algérie des camps et un livre Nancy-Kabylie2.
Quelle place occupent l’émotion et les sentiments dans votre travail journalistique au travers duquel vous documentez la mémoire collective algérienne ?
Mon père est pendant longtemps resté silencieux sur son histoire. Je pense que ce qui m’a vraiment interrogée, c’est sa très grande mélancolie par moments. Elle était liée à son exil, mais je n’étais pas capable de le nommer non plus. En tant qu’enfant, on est affecté par l’état émotionnel de ses parents, sans en comprendre les causes. Et c’est tellement envahissant émotionnellement, tellement bouleversant que je pense que j’ai eu besoin de comprendre les sources de cette mélancolie qui est vraiment constitutive de mon histoire. Aujourd’hui, j’utilise le terme de « nostalgérie », mais il faudrait dire les « nostalgéries ». À l’origine, ça décrit le sentiment de nostalgie des Européen·nes d’Algérie qui ont été contraint·es de quitter le territoire algérien et qui vivent une forme de déracinement, avec en même temps, pour beaucoup, le fantasme d’une grandeur passée. Et il y a aussi celles et ceux qui arrivent à questionner, à déconstruire, à se remettre en question sur leur place dans l’histoire. Enfin, je pense qu’il y a aussi une nostalgie dans beaucoup de familles d’exilé·es, d’immigré·es, descendant·es d’immigré·es, qui participe aussi à une sorte de fantasme du pays d’origine qui est mythifié, enjolivé, même parfois une sorte de ressource, de paradis ressource en comparaison avec ce qui est vécu en France. J’ai bien conscience qu’en réalité, nous sommes Français·es, mais on a tellement de difficultés à le dire du fait du contexte que c’est un peu la ligne de fuite. C’est la tentation aussi d’une échappatoire, mais qui dit en même temps quelque chose de cet attachement, de tous ces affects qui sont en jeu, qui nous mobilisent dans nos créations, dans nos réflexions, dans nos désirs.
Vous avez réalisé un film, produit un podcast, rédigé un livre… Quel rôle doit jouer la culture dans ce travail mémoriel ?
Je crois beaucoup à la culture et je pense qu’elle n’est pas du tout anecdotique. Je suis, par exemple, intervenue en prison et j’ai bien vu qu’à partir du moment où on était dans l’émotion, dans le sensible et dans la réflexion, il y avait une rencontre possible. C’est quand on assène des vérités qu’il y a une forme de résistance au discours. Moi, je pense que l’émotion déplace et permet d’ouvrir des espaces fondamentaux à l’intérieur de soi à une époque où on est tous en train de se figer et de se rigidifier sur des idées. Je crois vraiment que tous ces endroits de lecture, de projection, même parfois de chansons, sont des endroits que l’on peut ouvrir.
Vous reprenez le terme de « schizophrénie coloniale » que Karima Lazali développe dans son livre Le trauma colonial. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela représente ?
Il s’agit d’une sorte de concurrence dans les allégeances et dans les loyautés. Je pense que l’enjeu de notre génération, qui grandit notamment en France, c’est de réussir à faire un travail dialectique, à savoir qu’il y a une thèse, une antithèse et nous devons trouver comment faire la synthèse de ses héritages sans être dans l’amputation ni d’un côté ni de l’autre. Personnellement, je me suis apaisée grâce à mon travail de création et d’écriture. Mais il fut un temps où j’avais l’impression, lorsque je posais un choix, d’être en position de trahison d’un autre choix possible, ce qui crée des sentiments très douloureux de contradiction impossible à résoudre. Ces derniers sont mis en concurrence, et nous entrainent à nous questionner sur qui nous sommes vraiment.
Il n’en reste pas moins que le terme « schizophrénie » est un terme psychiatrique. À cet endroit précis, il est difficile pour moi d’approfondir davantage la question d’un point de vue médical. Mais je pense qu’historiquement, il serait intéressant de se questionner pour savoir s’il y a eu des recherches là-dessus, des cas de démence notamment. Je pense qu’il y a eu un vrai impact psychologique qui n’a pas été suffisamment travaillé.
Vous avez très tôt ressenti le besoin impérieux d’apprendre l’arabe. Qu’est-ce que cela représente pour vous d’apprendre la langue parlée par votre père ? Quelle est l’importance de la langue dans votre héritage ? Peut-elle être réparatrice ?
J’ai fait un chemin sans me rendre compte qu’il allait me ramener sur cette question. Comme je l’écris dans le livre, enfant, je me revendique de père algérien. Je me dis Algérienne, mais les autres me renvoient à un vide de transmission de la langue et de la mémoire. Petit à petit, j’ai conscience qu’il y a un endroit de vide que je cherche à combler. Et donc très vite, je deviens obsédée par l’idée d’apprendre l’arabe, mais cette obsession est aussi un moteur. Ironie du sort, j’ai réalisé bien plus tard que mon père ne parle pas l’arabe, mais le kabyle. Quoi qu’il en soit, la langue arabe fait aussi partie d’un héritage, et elle y occupe une place conséquente. Je pense que la langue est un point d’accès important. À travers la langue, on a accès à des imaginaires et à des mondes différents. En apprenant l’arabe, je me suis confrontée à des idées et à des pensées que ce soit en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Palestine, en Syrie, au Liban, ou ailleurs. En fait, avoir accès à la langue nous déplace, cela nous décentre. Et je pense que c’est tout l’intérêt de ce travail.
Tous ces déplacements dans des langues différentes m’ont aidée à mieux approcher et à mieux comprendre ces questions que je n’arrivais pas à formuler. Et je pense à ce rapport de l’UNESCO sur l’importance de l’enseignement dans la langue maternelle. Or le bilinguisme en France n’est pas du tout encouragé — à part pour l’anglais et l’allemand, éventuellement l’italien. On est à un niveau affligeant de reconnaissance du patrimoine linguistique. Je me dis qu’on perd beaucoup de temps et que ces langues, nos langues, disparaissent alors que cela crée beaucoup de mal-être de ne pas connaitre la langue de ses ancêtres, et donc de ne pas se sentir relié par les mots. Cela crée une sorte de hiatus douloureux.
Ceci rejoint également ce que vous partagez à l’égard de votre double prénom et de votre manière de l’écrire. Pouvez-vous nous expliquez ?
Il s’agissait pour moi de rendre visibles mes différents héritages. Mon prénom en France, c’est Dorothée. Mais j’ai un deuxième prénom, Myriam, et quand je vais en Algérie, mon père me présente avec ce deuxième prénom. J’ai donc décidé de garder mes deux prénoms pour me présenter. J’ai imaginé, en m’inspirant de ces « identités traits d’union » aux États-Unis, ajouter un trait d’union entre Dorothée et Myriam. Mais je me suis rendu compte que visuellement, ce trait, c’était aussi une négation : Dorothée moins Myriam. Ce n’était pas ce que j’avais envie de raconter. J’ai donc transformé ce trait d’union en astérisque en me disant que ce signe représentait une multiplication possible. Et c’est ça que j’ai envie de garder comme idée, celle d’une multiplication, d’une pluralité possible, pas d’une négation – une injonction bien trop dans l’air du temps avec la montée de l’extrême droite.
Dans votre ouvrage, vous vous demandez si les peurs que l’extrême droite met en avant ne renverraient pas à celles de l’ancien colon attaché à ses privilèges. Il me semble impossible de ne pas lier cette idée à la forte progression du Rassemblement National aux récentes élections législatives françaises…
C’est vrai que quand je présente mon livre ou mon film à des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, je les sens en vrai questionnement. Iels sont perdu·es dans leur construction personnelle et ne savent pas à qui se référer. Iels vivent un malaise quotidien parce qu’effectivement, iels subissent des violences symboliques, de dépréciation, des violences psychologiques de stigmatisation. Comment se construire avec cette violence subie, quand, en plus, on n’a pas hérité des richesses de son histoire ? Et c’est une vraie question d’actualité quand, grâce au travail d’enquête du journaliste Farid Alilat, on découvre les origines kabyles du leader du RN Jordan Bardella dont l’arrière-grand-père a immigré en France au début du 20e siècle. Alilat a retracé toute son histoire alors que son frère est retourné dans leur village d’origine. Ce travail d’enquête questionne. Quel type d’intégration est-ce qu’on propose en reniant un héritage ? Je crois vraiment que c’est cet endroit-là, celui de l’héritage et de la connexion à son héritage qui permet d’empêcher une violence et une haine de soi qu’on retourne ensuite contre l’autre. En fait, le discours dominant est tellement violent que par moments, moi, je me suis rendu compte que très inconsciemment, je peux moi-aussi intérioriser le mépris qui s’exprime à l’égard de soi. Il s’agit donc d’une résistance de tous les instants. Nous devons prendre conscience du climat raciste issu de l’héritage colonial. Celui-ci est très peu questionné et continue de nous toucher au niveau de nos inconscients. On doit vraiment s’en libérer. En outre, je pense qu’avec cette peur du déclassement des classes populaires, il y a effectivement la tentation de voter pour le RN puisqu’il reformule une domination raciale. Et ça, je trouve qu’il faudrait davantage le penser parce que ça nous bloque dans l’histoire, ça nous refige dans un moment de l’histoire qu’on n’a pas assez travaillé et qu’on ne veut pas travailler. Je pense que tant que ce ne sera pas vraiment fait, on restera dans des sortes de barrages permanents face à une extrême droite qui va être de plus en plus forte.
Vous avez vécu et travaillé en Palestine. Quel lien tissez-vous entre la lutte de libération de l’Algérie et ce qui se déroule en Palestine ? Y voyez-vous une lame de fond qui serait similaire ?
C’est vrai que tout ça était très inconscient pour moi, mais le fait d’avoir été en Palestine, d’avoir documenté l’occupation, ça m’a vraiment préparée au travail de recherche sur l’occupation française en Algérie. J’y étais en 2008 et 2010, au moment de l’opération « Plomb durci » à Gaza qui a fait plus de 1400 morts. J’ai assisté à l’expropriation de villages, de terres, à l’expulsion de familles. On était dans un contexte déjà hyper violent, et vraiment dans cette logique de dépossession historique assortie de la domination d’un peuple sur un autre. Ce sont des logiques que j’ai retrouvées dans l’histoire coloniale en Algérie.
La difficulté, et c’est là où on est piégé·es par l’histoire, c’est que, comme le dit Edward Saïd, les Palestinien·nes sont « les victimes des victimes ». C’est là que ça devient compliqué à penser puisque comme on a une approche manichéenne de l’histoire, il est devenu impossible de dire qu’il y a les bons et les méchants. C’est maintenant que nous allons avoir besoin du travail des historien·nes et qu’iels s’expriment publiquement, comme le fait Ilan Pappé, en affirmant que les anciennes victimes peuvent devenir des bourreaux. C’est à cet endroit qu’il faut cesser de ne pas questionner Israël aujourd’hui parce qu’on est dans une situation que lui, en tant qu’historien israélien, qualifie de génocide. On est encore ici sur une bataille de vocabulaire qui empêche de penser l’histoire. Il le disait encore très justement récemment dans une interview en déclarant que, pour évoquer l’expulsion forcée de 1948, les Palestinien·nes utilisent le terme de Nakba. Et en fait, nakba signifie catastrophe en arabe, ce qui sous-entend qu’il n’y aurait pas de responsable. Or, toute la question est de nommer les responsables. Je pense que dans le contexte de l’Algérie coloniale, étant donné qu’il n’y a pas eu de procès en raison des lois d’amnistie, on n’a pas nommé les responsables. C’est toute l’importance du travail des historien·nes qui vont, par exemple, citer le tortionnaire Jean-Marie Le Pen dans la casbah à Alger pendant la bataille d’Alger. Cela permet de retracer des responsabilités. Et donc oui, il y a toute la question de l’effacement, à la fois des crimes et des responsabilités, qui se rejoue aussi dans le contexte palestinien. D’où l’importance d’internationaliser cette cause, parce que ça a été le cas aussi pour l’Algérie. On voit bien qu’à Gaza, l’accès au territoire est bloqué pour les journalistes parce qu’il y a un enjeu d’information et de narration. Dans une certaine mesure, je retrouve ces enjeux autour de l’Algérie coloniale. Donc oui, c’est très similaire, et ce rapprochement dérange.
Il est donc nécessaire de poursuivre le travail et de documenter ce qui est en train de se dérouler pour visibiliser ce qui se passe là-bas du mieux qu’on peut…
Le plus possible, oui. Moi, je crois beaucoup au travail des historien·nes, des juristes aussi, c’est à cet endroit que ça va se jouer. Malheureusement, pour empêcher les crimes, là, on est tellement démuni·es. Même si on peut imaginer des solutions de sanctions, de pression, mais bon, voilà, la mobilisation importe, on l’a vu dans l’histoire de l’Algérie coloniale. Même on sait qu’elle est à la marge, il faut continuer à aller battre le pavé.
- Karima Lazali, Le trauma colonial, La Découverte, 2018.
- Dorothée*Myriam Kellou, Nancy-Kabylie, Grasset, 2024.