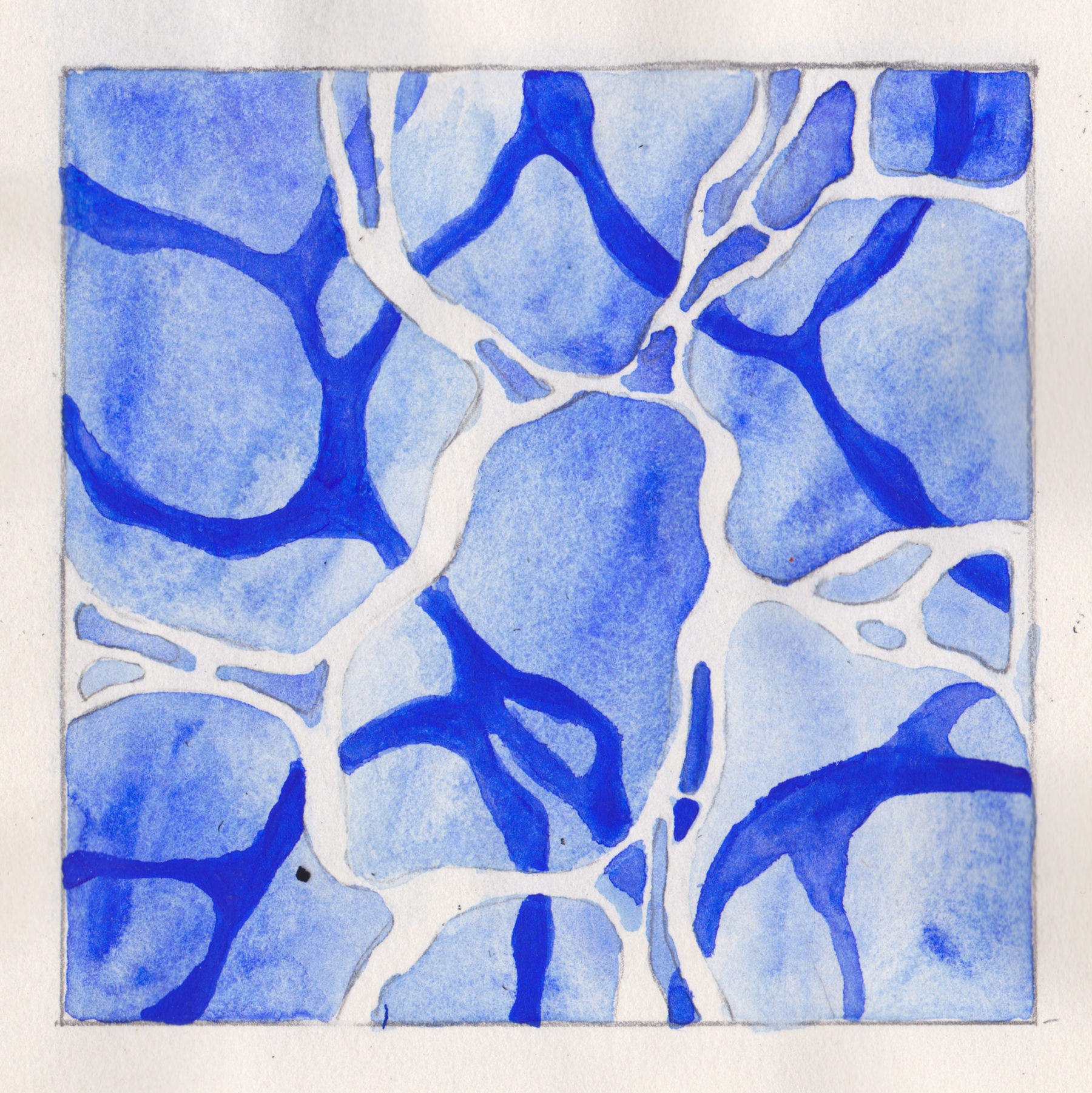Le résultat des élections fédérales, régionales et européennes de juin 2024 en Belgique a surpris par l’ampleur des voix portées à droite ou au centre droit. Pourtant, les signes de ce basculement culturel et politique étaient déjà perceptibles pour nous, mouvement d’éducation permanente, qui sommes quotidiennement en lien avec les citoyen·nes via nos actions locales
L’érosion de l’État social : un terreau fertile pour la droite
Depuis plusieurs années, deux dynamiques ont alimenté ce glissement. D’abord, la montée de la précarité économique et sociale. Encouragé par un capitalisme débridé, notre État social s’est peu à peu délité. Si son cœur n’a pas encore été atteint, cette érosion touche de nombreux citoyen·nes, en particulier celles et ceux qui ne disposent pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour affronter seul·es leurs difficultés.
Un État social affaibli entraine une perte directe de droits pour les plus fragiles et alimente la peur du déclassement dans la classe moyenne. Conscient·es de l’affaiblissement des mécanismes de solidarité portés par la sécurité sociale et les services publics, certain·es citoyen·nes ont intégré les discours de la droite : valorisation de la réussite individuelle, sur-responsabilisation des plus précaires, dénonciation d’abus supposés et accusation de générosité excessive envers les allocataires sociaux ou les personnes en situation de migration.
Déconstruire les discours de droite, construire des narratifs de gauche
Face à la dégradation du rôle social de l’État, les associations d’éducation permanente, les syndicats, mutualités, collectifs et autres organisations n’ont cessé de réagir. Ils tentent de déconstruire les discours populistes qui désignent des boucs émissaires comme responsables de l’affaiblissement de notre modèle social.
Dans ce travail, nous nous appuyons sur des données scientifiques solides, qui invalident la majorité des thèses de droite liées à la responsabilité des plus fragiles. Pourtant, malgré les chiffres et les analyses produites par les universités et centres d’étude, notre discours peine à atteindre le grand public.
Dans son essai Pourquoi les narratifs de gauche ne parlent plus aux classes populaires, Jérôme Van Ruychteveld explique les ressorts de cette difficulté [voir notre encadré]. Il s’appuie notamment sur la théorie des frames de George Lakoff pour illustrer l’impuissance du discours rationnel face à des cadres moraux puissants et à des narratifs simplistes.
Il faut aussi admettre qu’il manque à la gauche un véritable projet de société. Un projet capable de répondre aux crises du vivant, aux déstabilisations écologiques et sociales, mais aussi de faire rêver, de proposer un avenir désirable aux citoyen·nes.
Quelles promesses d’une vie meilleure la gauche porte-t-elle encore ? Les grands combats qui ont permis l’effectivité des droits fondamentaux pour des millions de personnes semblent n’avoir pas de descendances. Trop souvent, les partis de gauche, lorsqu’ils gouvernent avec la droite, se contentent d’adoucir des politiques antisociales ou stigmatisantes. Dans ces coalitions gauche-droite, ils peinent à faire émerger des réformes fortes, visibles, identifiables comme des avancées de gauche.
En l’absence d’alternative claire, face à la dégradation des conditions de vie et à la fragilisation des droits, une part importante de la population s’est tournée vers la droite. En proposant des coupables idéaux (toujours les plus précaires) et des solutions simplistes, la droite et le centre droit ont su convaincre, y compris parmi celles et ceux qui seraient visés par les mesures stigmatisantes proposées par ces forces politiques.
Pour des mouvements progressistes comme le nôtre, ce constat est douloureux. Il peut même entrainer une perte de sens dans notre travail, un découragement et l’impression que notre travail parfois peu tangible est vain.
Laisser les sédiments retomber pour y voir clair
Chez Présence et Action Culturelles, comme dans d’autres structures partageant nos valeurs progressistes, nous avons choisi de prendre le temps. Ce temps, nous l’avons assumé comme long et nécessaire. Loin du tumulte imposé par l’agenda politique et médiatique, nous avons rencontré des collectifs, partagé des analyses, relu des diagnostics, confronté nos certitudes.
De ce temps d’observation et de réflexion sont nées des pistes d’action. Et surtout, des balises. Des balises qui guideront nos luttes dans les années à venir. Elles allient des fondamentaux de notre ADN politique et pédagogique, et des ruptures nécessaires pour faire face aux bouleversements actuels. La première balise est l’humilité nécessaire pour entamer les changements qui nous reconnecteront à celles et ceux qui ne se reconnaissent plus dans un projet de société solidaire et juste.
Refuser la cadence de Bannon
L’une des caractéristiques du basculement politique récent est le rythme imposé par la droite, en particulier l’extrême droite. Ce rythme, d’abord médiatique, devient politique. Il répond à une stratégie clairement formulée par Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump : « inonder la zone » d’informations, même fausses, pour occuper l’espace médiatique, tirer l’opinion toujours plus à droite, et rendre acceptables des idées auparavant perçues comme extrêmes.
Ce phénomène, connu sous le nom de déplacement de la fenêtre d’Overton, décrit comment des idées jugées inacceptables deviennent peu à peu discutables, puis acceptées. Si nous n’avons pas de prise directe sur l’agenda des médias, nous pouvons choisir de ne pas subir cette cadence imposée. Refuser de réagir à chaque provocation, c’est réorienter notre énergie vers les citoyen·nes, plutôt que vers celles et ceux qui saturent l’espace public.
Parce qu’en réagissant systématiquement, nous jouons leur jeu. Nous amplifions leurs messages, même pour les contredire. Et nos arguments, eux, touchent peu leur cible.
Tisser un maillage de luttes
Nous pensons aussi que la force des mouvements progressistes réside dans leur capacité à s’articuler, à se compléter. Nos histoires, nos ancrages territoriaux, nos champs d’action sont différents. C’est une richesse et pas un frein. Il est fort probable que face à l’ampleur des défis sociaux et écologiques, nous devions être sur tous les fronts. Mais au lieu de démultiplier nos luttes, nous pouvons choisir de s’allier stratégiquement, en valorisant le collectif comme amplificateur et pas comme multiplicateur.
Plutôt qu’un front unique fantasmé, il nous faut accepter la diversité de nos organisations. Plusieurs tentatives de fronts larges, notamment après le Covid, ont échoué. Faute de résultats tangibles, mais aussi parce que les investissements humains n’étaient pas toujours en phase avec les priorités des structures impliquées.
Partons du principe que nous défendons des valeurs communes même si nous avons nos sensibilités. Tentons de rendre concrète l’idée selon laquelle nous luttons « ensemble quand c’est possible, seul quand c’est nécessaire. »
Écouter les colères, entendre les désillusions
Enfin, il nous faudra aussi prendre le temps d’écouter. Nombreux sont les citoyen·nes aujourd’hui qui sont déçu·es, et se sentent abandonné·es. Beaucoup ont le sentiment que la classe politique, au sens large, ne les entend pas et ne les comprend plus. Ce ressenti alimente un désamour croissant pour la démocratie, en particulier sa version électorale et ses principaux acteurs : l’État, les partis politiques, les corps intermédiaires.
Ces frustrations sont activement entretenues par les discours populistes de droite. Face à cela, il est essentiel d’adopter une posture d’écoute, loin des jugements et des postures moralisatrices. Car les citoyen·nes qui se sentent méprisé·es par la droite ont parfois aussi ressenti ce mépris dans le regard ou les discours des forces progressistes.
Rétablissons avec ces citoyen·nes déçus les valeurs fondamentales qui fondent la gauche comme le respect, la solidarité, l’égalité mais aussi la joie de partager des expériences humaines, le plaisir de se rencontrer en vrai pour échanger, la force de nos passions joyeuses partagées.
Pourquoi les narratifs de gauche ne parlent plus aux classes populaires
Face à la montée des populismes identitaires et de l’extrême droite, les analyses se sont souvent concentrées sur les stratégies gagnantes de ces courants antidémocratiques et sur les raisons qui poussent les classes populaires à voter pour eux. L’étude Pourquoi les narratifs de gauche ne parlent plus aux classes populaires propose un changement de perspective : et si la gauche avait elle-même perdu sa capacité à parler au cœur des gens ? L’auteur, le militant et communicant politique Jérôme Van Ruychevelt Ebstein, explore les failles narratives de la gauche, en faisant le lien entre psychologie sociale et analyses sociologiques matérialistes. Son terrain d’analyse est la Belgique francophone et s’appuie sur les discours diffusés lors de l’année électorale 2024.L’analyse montre comment les collectifs et les organisations progressistes ont perdu un lien social et affectif qui les connectait aux classes populaires, et comment cette déconnexion explique en grande partie l’échec de ses narratifs. Elle avance notamment l’idée que la gauche cherche trop à convaincre par des arguments rationnels et des principes éthiques froids, oubliant que la mobilisation repose sur des expériences vécues, des émotions partagées et des cadres mentaux adaptés. Une invitation à repenser ensemble les stratégies de la gauche sur le champ de la bataille culturelle. Ce texte ne porte pas seulement un regard critique, il ouvre également des pistes concrètes pour reconstruire une parole politique qui rassemble, qui touche et qui gagne durablement. On peut se procurer cette étude gratuitement via ce lien.