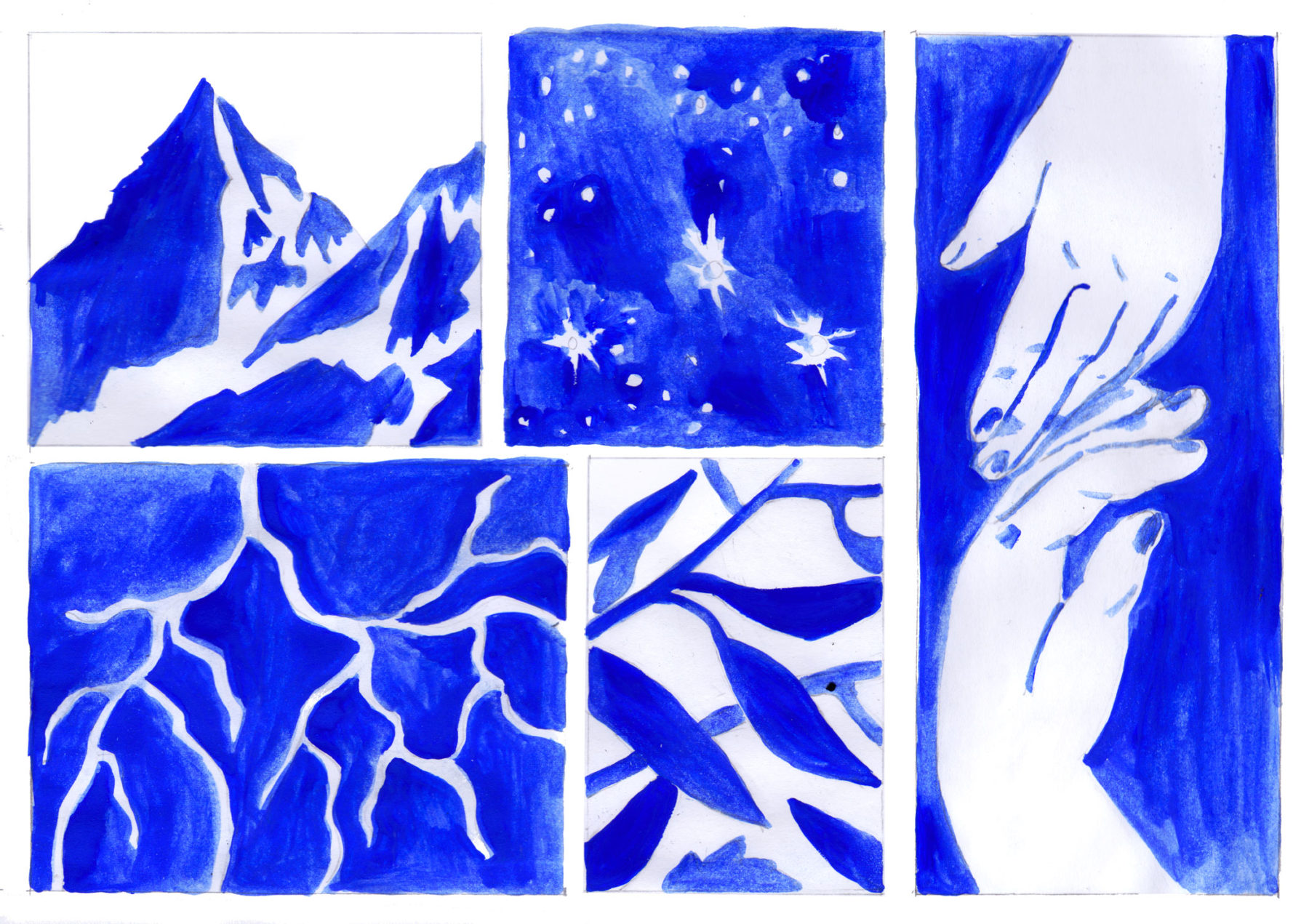D’où vous vient cette idée d’écologie culturelle ? Quelle est son origine ?
Cela faisait quinze ans que je créais des spectacles sur le thème de la nature et de l’écologie. Pour créer ces événements, je découvrais des textes incroyables de George Sand, de Victor Hugo, de Jean de La Fontaine, de Montaigne, etc. Ces artistes parlaient déjà d’écologie alors que le terme n’existait pas. À ce moment-là, j’ai réalisé que l’écologie en France était culturelle. Qu’elle est dans l’ADN de notre culture mais qu’on ne le sait pas, parce que personne ne nous l’enseigne. Par exemple, c’est George Sand qui a sauvé la forêt de Fontainebleau – située à 70 kilomètres de Paris – de l’abattage dans les années 1850. Avec les peintres de Barbizon, elle a fait pression sur le gouvernement pour qu’on arrête d’en abattre les chênes, et Napoléon III les a écouté. Il a décidé de préserver mille hectares de forêt, une première mondiale ! C’était en 1861, une véritable sanctuarisation. J’ai choisi l’appellation « Écologie culturelle » car ce sont tout d’abord les artistes qui, à l’époque, ont été à la manœuvre pour la protection de l’environnement en France.
En tant qu’artiste, vous avez décidé de vous lancer à leur suite …
Je me suis dit qu’étant artiste, j’étais totalement légitime à m’exprimer sur l’écologie, et j’ai voulu créer un mouvement de pensée qui apporte un autre regard sur cette question. Si je le nomme « Écologie culturelle », c’est aussi parce que ce n’est pas un mouvement politique. Tout de suite, je me suis trouvé des alliés. Je me suis ainsi associé avec Nicolas Escach (Directeur de Sciences Po à Caen) et Pierre Gilbert, qui est prospectiviste en risques climatiques. Ces gens naviguent dans des cultures très différentes de la mienne. C’est ce qui fait sans doute notre force. Ensemble, on a écrit trois manifestes en trois ans. Grâce aux réactions du public lors de mes spectacles et à mon travail au sein du mouvement, j’ai compris qu’on parlait peut-être d’écologie de manière inadéquate. Nous faisons fausse route en mettant toujours la science en avant, parce que tout le monde n’est pas censé aimer la science, ni même la comprendre ou vouloir la comprendre.
À la lecture de votre ouvrage, on comprend que vous souhaitez re-susciter du désir à l’égard de l’écologie qui a pu exister et qui a un peu disparu du fait que la population ressente l’écologie comme punitive ?
Tout à fait. Mais au-delà de ça, je voudrais d’abord évoquer le libéralisme et le néolibéralisme. Je suis le premier à les critiquer, néanmoins, il faut leur reconnaitre le fait qu’il s’agit de véritables philosophies. Les néolibéraux ne sont pas uniquement des gens qui ont bêtement les dents longues. Cette pensée philosophique est très forte et je pense que l’écologie doit se construire une pensée aussi solide que celle-là. Parmi les stratégies de cette pensée, le libéralisme et le néolibéralisme se sont « inquiétés » des gens, de leur intimité, de leur pensée, de leur désir pour les toucher là où ils pouvaient l’être. Or, c’est en se mettant à la portée des gens que l’on convainc en politique, en économie, et donc aussi en écologie.
Pourquoi le discours raisonnable et scientifique tenu actuellement par nombre d’écologistes est-il insuffisant ? Car les gens veulent être touchés, dans leur quotidien, dans leur cœur, dans leurs affects. Ils s’en moquent de la science. Si elle leur fait du bien, tant mieux, si elle leur fait du mal, ils s’en éloignent. Mais en revanche, tout le monde a des désirs, des envies, des instincts. Tout le monde aime quelqu’un, sa famille, son compagnon ou sa compagne, ses amis, Cet accès sensible à la compréhension, qui touche à l’intime et à la vie de tous les jours peut toucher au cœur de n’importe qui. Et du côté de l’art, qui n’aime pas au moins une chanson ?
Le sensible est plus déterminant que les graphiques et les pourcentages. Si les gens n’ont pas envie de faire d’efforts pour l’écologie, on doit pouvoir les toucher autrement. Le libéralisme, lui, a su le faire de manière très intelligente en entrant dans notre intimité, dans nos foyers, dans notre sexualité. Si bien qu’on a l’impression que ça a toujours été comme ça. À mon sens, l’écologie doit s’élever au-delà d’elle-même, arrêter d’être un sujet de spécialistes, d’activistes ou de gens bien informés. Elle doit devenir un sujet de société.
Et pour moi, un sujet de société, c’est quelque chose qui nous parle, quel que soit notre niveau de compréhension et d’éducation. En tant qu’artistes, je pense que c’est notre métier depuis la nuit des temps de faire passer ces messages. Notre boulot a toujours été de vulgariser, de faire sentir des choses qui sont un peu hors de portée, pour les rendre accessibles, désirables et supportables.
Vous évoquez la nécessité de raconter de nouvelles histoires, mais comment faire ?
Je pense qu’il faut beaucoup écouter son intuition et ses besoins. On ne veut pas créer une nouvelle histoire. On crée une nouvelle histoire non seulement parce qu’on en a envie mais aussi et surtout parce qu’on en a besoin et qu’on sent qu’elle est prête. Et cela peut prendre beaucoup de temps. Moi, je le fais au travers de mes spectacles. Le dernier, intitulé Éloge de la forêt, est vraiment basé sur l’émotion, des choses qui touchent, au travers de la farce, ou parfois même du drame. Par exemple, pour dénoncer la bétonisation des sols, on met une vraie bétonnière sur scène. Elle tourne, et il y a un paysan-acrobate qui fait une danse avec la machine. Dans un premier temps, il ou elle valse avec elle ; puis il rentre dedans, en ressort, mais à chaque fois plus dépouillé de ses vêtements. Il finit quasi-nu et comme anéanti, comme ces paysans qui finissent par être dépouillés de leur culture et de leur terre, pour la construction d’une autoroute ou d’un entrepôt Amazon. C’est une manière de symboliser cette violence.
Pour moi, l’écologie touche à tous les sentiments de l’être humain. Il faut donc qu’elle soit humaine, en profondeur. Oui, je suis en colère contre les anti-écolos, mais aussi parfois contre les écolos parce qu’ils vendent mal ce à quoi ils croient et ce à quoi je crois aussi. Je pense sincèrement qu’il faudrait vraiment faire différemment. Mon idée, c’est de partir de l’émotion pour faire saisir, comprendre et incarner les choses. Une idée désincarnée ne peut pas toucher les gens, sauf ceux qui font un effort parfois considérable pour s’en approcher.
J’ai également créé l’Écologie culturelle pour créer un « contre-feu ». Actuellement, je trouve que l’écologie est trop exclusivement descendante : de ceux qui savent (les scientifiques, les avertis) vers ceux qui ne savent pas. Je travaille pour une écologie ascendante, fabriquée avec les gens de terrain. Ce double mouvement est essentiel. D’autant qu’à ma connaissance, c’est aussi la promesse de la démocratie. Ma vraie ambition est là. Les scientifiques font très bien leur travail, les politiques font ce qu’ils peuvent. Mais nous, citoyens et citoyennes, on a une autre destinée, c’est nous qui faisons la société. On doit développer d’autres voies : nous sommes toutes et tous des « faiseurs » du réel. Pour moi, la réalité d’une idée qui soit populaire, c’est qu’elle parle à une majorité dans la population, quel que soit son niveau de vie. Cela implique de revoir les fondamentaux de notre société pour plus de liberté, d’égalité, de solidarité afin d’arriver à un vrai projet de société. Si le projet, c’est de dire qu’il ne faut pas qu’on dépasse 1,5°C de réchauffement, ça ne fonctionnera pas. D’abord, cela n’a jamais fait un projet de société et deuxièmement, cela valide inconsciemment l’idée qu’avant ce seuil tout va bien, ce qui est faux !
Au sein de votre mouvement, on découvre les Maisons de l’Écologie culturelle. Comment s’y inscrivent-elles ? Quel est leur projet ?
En France, beaucoup de gens disent qu’ils vont « sauver le monde » avec leurs petits bras. Et moi, j’en ai marre, parce que c’est faire peser sur les gens, notamment sur la jeunesse, un poids tellement insupportable qu’ils pourraient péter les plombs. Dans nos premiers manifestes, on disait que ce serait bien de créer des « Maisons de l’Écologie culturelle » comme Malraux l’a fait après la guerre, avec les Maisons de la culture, pour que chacun et chacune ait accès à la culture quel que soit son origine. Dans le même esprit, nous disons que l’enjeu aujourd’hui, c’est que tout le monde ait accès à l’écologie, quel que soit son niveau d’éducation et de vie. Parce que c’est l’enjeu sociétal d’aujourd’hui, de demain et pour pas mal de temps encore.
À la publication de nos manifestes, des gens nous ont contacté en nous disant que ce qu’on avait écrit, cela ressemblait à des choses qu’ils faisaient. On n’a pas fait d’appel au peuple, ça a démarré comme ça, naturellement. Grâce à ces gens qui se sont rapprochés de nous, il existe aujourd’hui treize Maisons de l’Écologie culturelle. C’est emblématique. Je pense notamment au petit village de Bécherel en banlieue de Rennes, qui compte 17 librairies pour 500 habitants. Ils se sont rassemblés en association et travaillent depuis 20 ans sur ce lien entre culture et écologie. Cette association a rejoint le mouvement. Mais les gens n’ont pas besoin de nous pour créer. On s’assied, on se confronte à des gens qui ont déjà une expérience du terrain et du territoire, qui y sont déjà reconnus et qui ont une légitimité. Et on leur propose de travailler avec nous pour que l’écologie devienne un sujet de société partagé.
Nous pouvons également faciliter la création de nouvelles Maisons. Les gens sont autonomes, même s’il existe une charte et une labellisation. Et ce qu’ils attendent de nous, c’est plus de visibilité, que nous les mettions en lien aussi puisque les Maisons sont dispersées aux quatre coins de la France, de l’Alsace à la Normandie en passant par Perpignan. Notre objectif est de leur permettre de se réunir pour « monter en gamme » en s’enrichissant mutuellement, qu’il s’agisse d’ateliers, de tables rondes, de spectacles, ou encore de travail de la terre.
Nous mettons en avant que tout est culturel. Il n’y a pas que l’art, qui est la partie la plus émergente, celle qu’on voit, qu’on retient et qui va ensuite se trouver dans les musées, etc. La vie de tous les jours est tout aussi culturelle, précieuse et déterminante. Notre façon de nous habiller, de converser, toutes nos habitudes, ce qu’on appellera plus tard une civilisation est culturel. C’est là-dessus qu’il faut influer, c’est là que ça va se sentir et se jouer. Et c’est là qu’on peut faire une écologie qui rassemble sans, dans une certaine mesure, que les gens ne s’en rendent vraiment compte, ou le nomment comme cela. J’appelle cela la « banalité bienfaisante du quotidien ». C’est tout ce que les gens souhaitent, mieux vivre et être plus heureux. L’Écologie doit le promettre et y travailler.