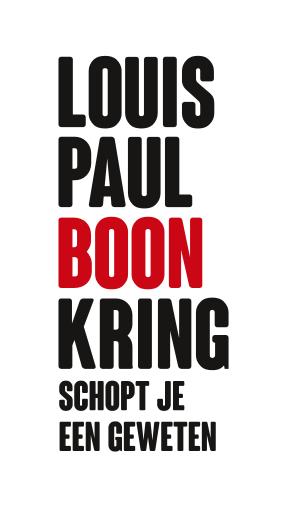Comment le Cercle Louis Paul Boon se définit-il politiquement ?
Le cercle Louis Paul Boon est une association de gauche, qu’on pourrait qualifier politiquement de rouge-verte. Son engagement social guide le choix de ses thématiques, nourri par une profonde indignation face à l’injustice sociale, les inégalités, l’oppression, les violations des droits humains et la dégradation de l’environnement. Sur le plan politique, il réunit des gens aux sensibilités variées – Vooruit, Groen, PvdA – ce qui favorise une diversité de points de vue.
Cette hétérogénéité permet d’élever le débat, d’élargir nos perspectives et de mobiliser de nombreux réseaux différents. Nous saluons l’indépendance du secteur socioculturel vis-à-vis des partis politiques, mais nous regrettons amèrement la dépolitisation progressive de ce secteur imposée par le gouvernement flamand. Une tendance qui s’est ressentie dès les années 1980 sous des ministres de la culture libéraux comme Karel Poma et Patrick Dewael et qui s’est renforcée depuis.
Qui était Louis Paul Boon ?
Boon était un écrivain flamand engagé. Mais en plus d’être un auteur de poésie, de romans, de nouvelles, de critiques littéraires et artistiques, il était aussi une figure médiatique, un tendre anarchiste, un communiste, un chroniqueur, un bon vivant… Nous cherchions un nom porteur de sens dans lequel nous pouvions nous retrouver.
Quelles activités phares ou grandes campagnes de sensibilisation avez-vous mises en place ces dernières années ?
En 2024, nous avons lancé la campagne « Extrême droite, non merci / extreemrechts nee bedankt », un grand projet de sensibilisation en Flandre et à Bruxelles visant à alerter et rendre conscient la population des dangers de l’extrême droite. Cette année, nous avons également lancé un grand projet autour de l’exclusion numérique. Par ailleurs, face au blocage des institutions politiques bruxelloises depuis neuf mois, nous avons aussi rassemblé la société civile bruxelloise – néerlandophone, francophone et multilingue – pour dépasser la polarisation actuelle. Ensemble, nous avons rédigé un appel, « Nous existons toujours ! / Wij bestaan nog altijd !», que nous soumettons à signature.
Comment fonctionne le cercle ?
Le cercle fonctionne en tant qu’association de fait et rassemble 125 membres. Nous recevons un subside annuel de la VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) c’est-à-dire la Commission communautaire flamande. Nous sommes également affiliés à la structure Curieus vzw, anciennement connue sous le nom de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (Centre pour une politique culturelle socialiste. Historiquement, Curieus présente de nombreuses similitudes avec le mouvement d’éducation permanente PAC.
Pour quelles raisons le décret qui régissait l’éducation populaire en Flandre a‑t-il été supprimé ?
L’éducation populaire été remplacée petit à petit dans les années 1980 et 90 par l’idée de tweede kans onderwijs (« enseignement de la deuxième chance »). En Flandre, comme d’ailleurs partout en Europe, l’enseignement est peu à peu devenu un socle préparatoire pour le marché de l’emploi plutôt que d’être un lieu d’éducation des citoyen·nes. Cela a aussi influencé le secteur de l’éducation permanente. Le secteur socioculturel s’est ainsi fortement professionnalisé, les subsides ont été de plus en plus liés à des projets, ce qui a notamment mené à son instrumentalisation par le politique. Dès lors la société civile flamande a perdu son rôle critique et de réflexion. C’est d’ailleurs un point que nous souhaitons fortement réfléchir dans les temps qui viennent.