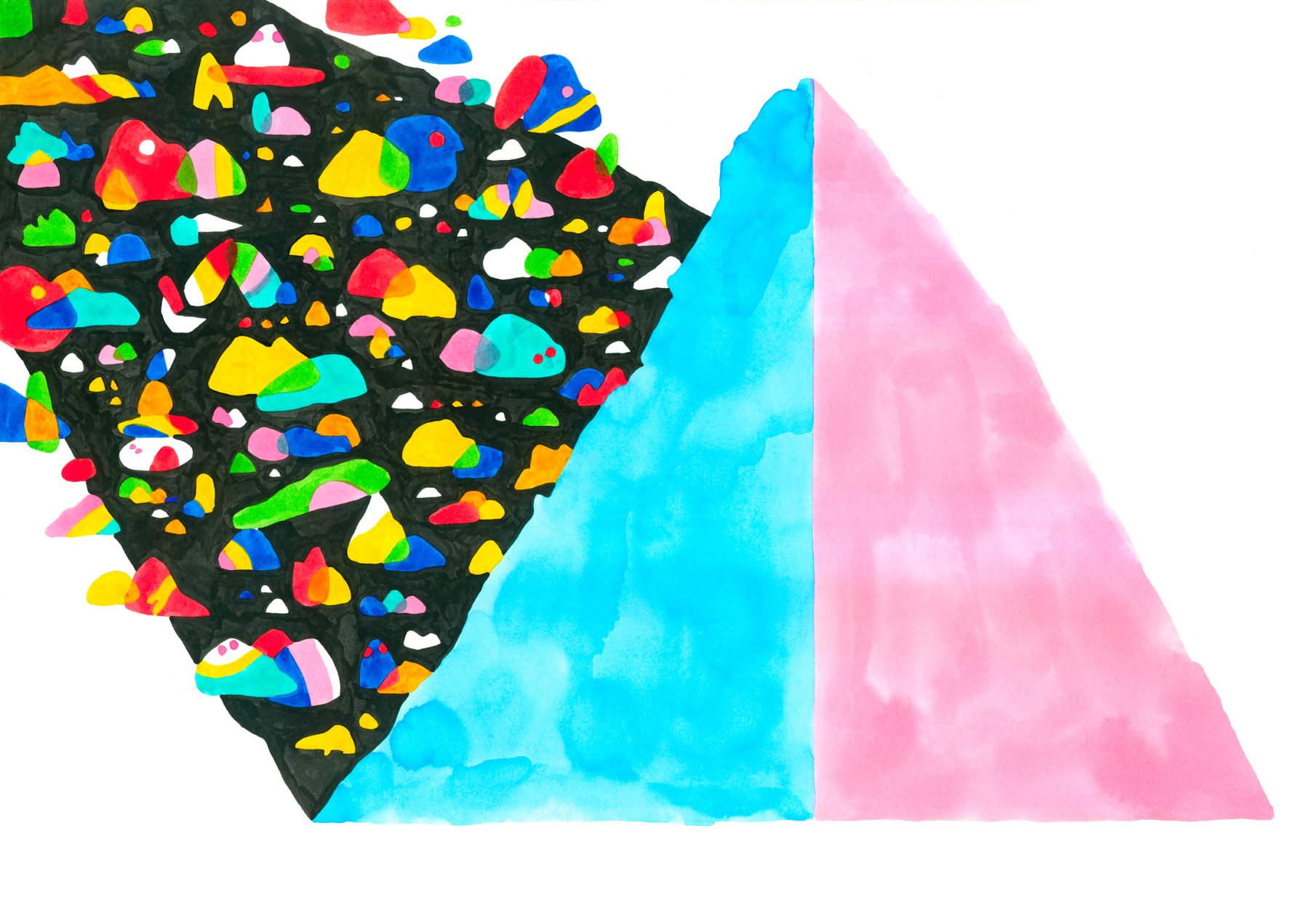Sexualités et dissidences queers est un ouvrage pédagogique qui permet de penser les rapports de pouvoir et les imbrications entre l’oppression sexuelle et les autres formes d’oppression liées le plus souvent à l’hétérocisnormativité généralisée qui est la présomption qu’être un homme ou une femme cisgenre sont les seules identités de genre et que l’hétérosexualité est la seule norme valide. De l’ordre sexuel normatif à la roue du consentement en passant par le polyamour, les paniques morales liées aux communautés LGBTQIA+, les corps dissidents ou l’analyse critique de la pornographie, chaque contribution est un outil didactique d’une rare clarté. Entre pratique de terrain et écriture académique, Chacha Enriquez revendique un travail de sociologie appliquée dans une langue très accessible avec peu de références et autre langage jargonneux en faisant confiance aux lecteurices. Alors, toustes normé·es ? Oui ! Mais la voie vers davantage de fluidité est ouverte !
L’élément central de l’ensemble des textes rassemblés dans cet ouvrage est le concept de norme. Il apparait que nous sommes toustes normé·es et que nous entrons toustes dans des cases. Et pourtant, vous dites que nous sommes également toustes des dissident·es d’une manière ou d’une autre. Comment s’empare-t-on de cela ? Et comment peut-on rester dissident·e alors que tout nous pousse à nous intégrer dans les normes ?
La première chose essentielle est la prise de conscience. Toustes les auteurices nous invitent à saisir l’action du pouvoir normatif à combattre. Parce que qui dit norme dit contrôle social. Et tout l’enjeu pour nous est d’identifier le contrôle social sur les sexualités pour comprendre comment nos sexualités sont régulées, orientées, mais aussi les violences qu’elles impliquent. Il s’agit de se donner des outils collectifs pour identifier cela et se sentir mieux avec nous-mêmes pour être capables de nous connecter de manière plus juste avec nous-mêmes, nos sexualités, nos désirs, nos plaisirs, nos limites. C’est quelque chose de vraiment important, cette idée de l’exploration et de l’affirmation puisqu’on nous en empêche au quotidien. Le tabou sexuel, qui est toujours extrêmement présent dans nos sociétés, nous empêche d’avoir ces conversations et ces réflexions.
Vous évoquez le contrôle social de nos sexualités, qu’entendez-vous par là ?
Il existe un contrôle social formel, qui passe essentiellement par une criminalisation des pratiques, et un contrôle social informel. C’est ce dernier qui nous a intéressés davantage pour l’écriture de tous nos textes. Il existe de nombreux mécanismes de régulation très puissants au travers des discours et des pratiques, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On peut penser au slutshaming, qui est lié au stigmate de la pute ou de la salope, et qui consiste à réguler la quantité de partenaires et de pratiques autour de la notion du « trop », un mécanisme très genré par ailleurs. Montrer trop de désir, avoir trop de partenaires, montrer trop de peau, tout ça entraine le risque de se faire insulter. Ce mécanisme de régulation s’articule, par exemple, dans tous les discours sur l’hypersexualisation des jeunes filles ou le contrôle des codes vestimentaires. Au travers de ce dernier, on sexualise les jeunes filles, on sexualise leurs vêtements.
On pense également à la présomption hétérosexuelle, et ce dès le plus jeune âge. On va présupposer que dès qu’un garçon et une fille interagissent, iels sont en train de se draguer, peu importe leur âge. On présuppose que l’amitié entre garçons et filles est impossible et qu’il y a forcément un rapport de séduction. Les adultes projettent l’hétérosexualité sur les enfants, mais à l’inverse, on ne va jamais penser que deux petits garçons ou deux petites filles peuvent être amoureux·ses. Ce sont des mécanismes qui nous construisent et qui participent du contrôle social.
Vous parlez également toustes beaucoup des insultes et de pathologisation. Doit-on comprendre que tout est problématique lorsqu’on est en dehors de la norme hétérosexuelle ?
Tout ce qui est lié à l’insulte et à la stigmatisation sont des manières de nous faire comprendre que ce n’est pas normal, qu’on est n’est pas normal. Nous sommes des minorités insultées et insultables, comme le dirait Didier Eribon. Lui, il dit que « On comprend qui on est en comprenant qu’on est ce qu’il ne faut pas qu’on soit ». Il faut aussi parler de l’association avec la perversion, et donc la pathologisation. On va tout le temps nous dire que nous avons des problèmes de santé mentale, que les personnes qui pratiquent le BDSM1 ou les personnes trans sont des malades mentales, que les personnes asexuelles2 sont frigides. Tout est un problème de santé mentale dès qu’on a une sexualité qui n’est pas normative.
Et pour ce qui concerne le contrôle social formel, vous pourriez nous donner un exemple ?
La criminalisation est une forme de contrôle social formel. Nous l’avons un peu travaillée, pas uniquement sur ce que disent les lois, mais aussi sur la manière dont les forces policières et judiciaires agissent. Un des premiers exemples qui me vient en tête est la question du divorce et de la garde des enfants. Une personne qui est identifiée comme dissidente de l’ordre sexuel est beaucoup plus à risque de perdre la garde d’un enfant. Si elle est travailleureuse du sexe, si elle pratique le BDSM, si elle a déjà fait de la pornographie, tout cela peut être retenu contre elle. Or, on se demande en quoi ces pratiques peuvent avoir un rapport avec sa capacité parentale.
La question de la parentalité traverse également de nombreux textes. Que font toutes ces normes à la parentalité ? Qu’est-ce que cela provoque chez les personnes queers3 ou dissidentes sexuelles ?
Il est important de préciser que la mise en relation est elle aussi très régulée, tout comme le type de partenaires. On sait qu’il y a des personnes avec lesquelles il faut se mettre en relations plus que d’autres. Et ça, c’est traversé par tout un ensemble de normes, d’oppressions et de rapports de pouvoir. On nous encourage à aller vers certaines personnes et pas vers d’autres, et cela constitue un rapport important. Pour ce qui concerne les parentalités, je pense notamment à la pluriparentalité4, qui est en lien avec le polyamour5. Les normes nous poussent au couple hétérosexuel monogame. C’est quelque chose d’extrêmement fort, mais qui est surtout très appauvrissant parce que cela signifie que notre destin est défini dès notre naissance. On est censé, à un moment donné, se mettre en couple avec une personne, faire des enfants, être dans notre famille et ce serait tout ce qui compte. Le modèle à suivre est l’hétérocisnormativité6. Ce modèle est très fermé, les relations y sont très étriquées. Et quand tu essayes d’avoir des parentalités alternatives, c’est là que tout peut devenir très compliqué.
Chez les personnes queers, la pluriparentalité est très répandue. Un·e enfant peut donc avoir plus de deux parents, mais ces derniers n’ont aucune reconnaissance. C’est un enjeu extrêmement important puisque cela signifie que certains des parents ne peuvent pas passer les frontières avec l’enfant, ne peuvent pas l’accompagner à l’hôpital, par exemple. Or, cela arrive fréquemment qu’il y ait trois ou quatre adultes qui décident de faire un enfant ensemble. Cela peut s’avérer très riche, pour un·e enfant, d’avoir plusieurs adultes référent·es. N’y aurait-il pas d’autres statuts à créer ? C’est ça aussi, tout l’enjeu.
Ce type de relations est très présent, historiquement, dans les communautés autochtones chez nous au Québec. Je pense par exemple à une ainée bispirituelle7 qui est en relation lesbienne depuis très longtemps et qui a des enfants. Ces dernier·es sont les enfants d’un membre de sa famille qui en avait beaucoup, et elle a eu avec elleux un rapport privilégié. Finalement, elle les a un peu « adoptés », mais cela s’est fait de manière très naturelle et ça n’a pas été une quelque chose de très compliquée.
Vous en appelez donc à davantage d’informalité ? De fluidité ?
Dans le livre, il y a un grand appel à la fluidité. Je le dis parce que je pense que chez les personnes queers, nous sommes nombreux·ses à avoir des rapports très conflictuels avec nos familles, à avoir des traumas familiaux, à venir de familles très toxiques et desquelles on se tient souvent très loin. Nous sommes ainsi habitué·es à créer des liens familiaux choisis, des familles choisies. Je suis convaincu·e que cela ne peut nous faire que du bien d’instaurer davantage de fluidité dans nos liens et nos relations. Je crois très fort au pouvoir transformateur des communautés queers. On amène des modèles de vie alternatifs, et on lève des barrières. On dénonce des situations invivables, on mène des batailles qui portent leurs fruits. Il était invivable auparavant d’être en relation homosexuelle et nos combats ont permis de reconnaitre le mariage, l’adoption, ce qui fait qu’aujourd’hui, on peut être gay, lesbienne et avoir des enfants. C’est juste le fait de mener nos vies qui permet que de plus en plus de personnes peuvent le faire. Cela entraine aussi le fait que les nouvelles générations sont de plus en plus queers puisqu’on a levé les barrières qui se dressent devant les vies LGBTQIA+. De plus en plus de personnes peuvent s’interroger sur qui elles sont et creuser la queerness qui est en elles. Toutes les luttes qui ont été menées par nos ainé·es, les luttes que nous menons et celles que mènent les nouvelles générations transforment la société et font qu’on est de plus en plus nombreux·ses, on gagne du terrain.
Pourtant, les forces conservatrices restent très présentes, notamment en affirmant continuellement la neutralité et l’universalité de l’hétéronormativité.
Les forces conservatrices veulent nous empêcher de pouvoir discuter avec les enfants et les adolescent·es et de pouvoir créer des liens parce qu’elles veulent obliger les enfants à devenir hétérosexuel·les et cis. Elles ne veulent pas que les enfants se posent des questions. Elles nous parlent de « propagande » LGBTQIA+ du simple fait que nous existions. En réalité, c’est plutôt une propagande hétérosexuelle et cis qui est mise en place dès le plus jeune âge pour nous obliger à… En fait, on baigne tellement dans la norme qu’on ne comprend pas que c’en est une. Et donc, dès qu’on rend visible l’alternative à la norme, c’est assimilé à de la propagande alors que cela ne prend pas tant de place que cela. L’objectif des conservateurs n’est pas in fine de protéger les enfants mais bien de maintenir l’hétérocisnormativité dans le futur, en obligeant les enfants à la subir. C’est donc ça leur vision de la protection des enfants !
Quelques mots sur la police, également. Dans l’ouvrage, il est question de consentement, de culture du viol, de normes formelles, peut-on imaginer améliorer la formation du corps policier pour que toutes ces questions soient mieux prises en compte par cette institution ? Comment la question de la police et celle de l’hétérocisnormativité s’articulent-elles ensemble ?
Moi, personnellement, je suis pour l’abolition de la police, c’est sûr. Mais la question va bien au-delà de ça et les enjeux sont extrêmement complexes. Ce n’est pas du tout une mauvaise chose d’essayer de former les policier·es, néanmoins, les institutions policières ne sont outillées et donc pour ce qui est du traitement et de la gestion par la police de tout ce qui concerne les questions de sexualité, cela ne fonctionne jamais. Et puis elles restent, à la base, des institutions de répression. Moi, je pense qu’il faut définancer la police pour tout ce qui concerne les questions de sexualité et avoir des institutions autonomes pour les gérer. Historiquement, nous avons été victimes de la répression policière et une partie des sexualités restent aujourd’hui, même si moins qu’avant, criminalisées. C’est pourquoi la police n’est, à mon avis, pas la bonne institution. Il faut trouver des alternatives qui permettent de travailler à une transformation en profondeur. Par exemple, on sait qu’il faut qu’on travaille sur les questions de consentement dès le plus jeune âge puisqu’on sait que dès qu’on est socialisé, on grandit dans la culture du viol. On est construit dans cette culture sans aucun espace pour discuter de sexualité. Il me semble essentiel d’ouvrir des espaces de conversation et de discussion sur ces thématiques comme alternative à la répression.
Pour conclure votre ouvrage, qui donne une vision de ce sur quoi vont porter vos futurs travaux collectifs, vous écrivez « l’hétérocisnormativité est un projet raciste et colonial ». Pourriez-vous revenir sur cette idée ? Cela mérite quelques mots pour nos lecteurices !
Nous avons travaillé l’hétérocisnormativité dans un cadre plus large pour tisser des liens entre l’ordre sexuel, l’ordre du genre, l’imposition de la binarité de genre, l’ordre corporel et l’imposition de la binarité des corps sexués. Ce dont on s’est rendu compte au cours de nos recherches, c’est que tout ça a été imposé à travers le monde de manière coloniale. C’est drôle d’entendre les chroniqueur·euses d’extrême droite qui viennent nous dire que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu une binarité des genres et de se rendre compte qu’iels mentent. Ce qu’on voit, c’est que dans la plupart des peuples autochtones, les sociétés n’étaient pas genrées ou multigenrées. Le genre n’était pas le centre de l’organisation sociale et chez nous, dans les communautés autochtones du nord de l’île de la Tortue [façon de désigner la Terre dans les récits de création de certains peuples premiers au Canada et aux États-Unis. NDLR], il y a beaucoup de femmes qui pouvaient être cheffes, par exemple. Et puis il y a les personnes qu’on appelle bispirituelles, des personnes aux deux esprits, qui ont une conception beaucoup plus fluide du genre avec trois, quatre, cinq, six genres… donc c’était beaucoup plus complexe que ça, en fait ! Et quand la colonisation est arrivée, elle a imposé la binarité de genre, l’ordre sexuel, l’hétérosexualité, le mariage hétérosexuel qui implique que les femmes deviennent la propriété de leur mari, ce qui n’était pas le cas avant. La colonisation a imposé un ordre hétérocisnormatif et hétérocispatriarcal. En faisant disparaitre la diversité de genre, ce qui a d’ailleurs constitué un argument pour dire « regardez, iels sont à l’état sauvage », les personnes autochtones ont été déshumanisées, qualifiées de dissidentes sexuelles, ce qui a justifié la colonisation avec sa mission civilisatrice, l’imposition du christianisme et de la famille hétérocispatriarcale. Et ça, ça a été le cas partout dans le monde. On le voit en Inde, par exemple, où la loi qui criminalise l’homosexualité date du moment de la colonisation britannique ou dans les pays du Maghreb où il y avait beaucoup plus de pratiques et de diversités sexuelles avant la colonisation européenne. C’est toutes ces questions qui seront développées dans le deuxième volume qui sera porté par les premier·es concerné·es
- L’acronyme BDSM signifie bondage/discipline ; Domination/soumission (Ds), sadomasochisme ℠. Le terme permet de rassembler un ensemble de pratiques qui ont en commun l’érotisation de l’échange de pouvoir. NDLR
- L’asexualité, tout comme l’aromantisme, sont des spectres représentant diverses formes et degrés d’attirances. Plusieurs identités font partie de ces spectres et ce qui rassemble toute cette diversité au sein de la communauté que l’on appelle « aro/ace », c’est l’absence commune d’attirance sexuelle ou romantique. NDLR
- Queer est un terme initialement péjoratif (bizarre, étrange), particulièrement adressé à l’encontre des personnes LGBTQIA+ à partir du 19e siècle, les désignant comme déviant·es, que des membres de la communauté se sont réapproprié·es à partir des années 1990. Il recouvre généralement une dimension plus politique des minorités sexuelles et de genre car il suppose une volonté de sortir des normes, qu’elles soient sexuelles ou de genre. NDLR
- Situation familiale dans laquelle au moins trois adultes ont un rôle parental vis-à-vis d’un·e enfant. NDLR
- Orientation relationnelle qui permet d’être en relation affective et/ou amoureuse avec plusieurs personnes de manière non-exclusive de façon éthique et consentie. NDLR
- L’hétérocisnormativité est la présomption qu’être un homme ou une femme cisgenre sont les seules identités de genre et que l’hétérosexualité est la norme valide, que les relations hétérosexuelles sont la référence pour la détermination de ce qui est normal ou non, que la famille nucléaire est un horizon indépassable et que tout écart par rapport à cet idéal peut être logiquement considéré comme anormal. NDLR
- La bispiritualité est une stratégie ou un outil d’organisation communautaire et une façon de se décrire. Il s’agit d’un moyen d’organiser les autochtones qui incarnent une diversité de sexualités, d’identités et d’expressions de genre, et de rôles relatifs au genre. Ce terme vise à aider les autochtones à établir des liens avec des expressions et des rôles qui sont propres à leur nation relativement au genre et à la diversité sexuelle. NDLR
Sexualités et dissidences queers
Coordonné par Chacha Enriquez
Remue-Ménage, 2024