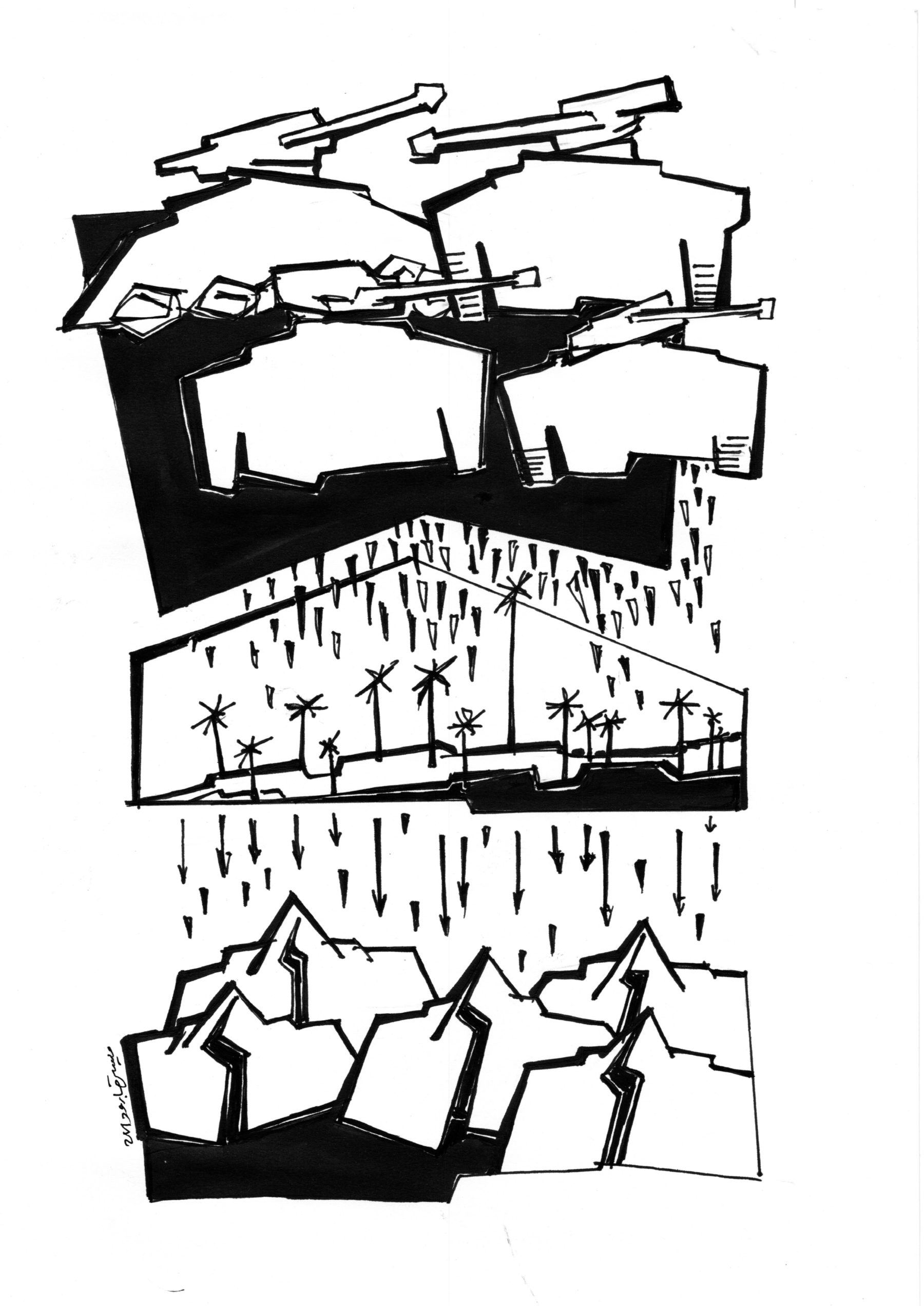[Entretien réalisé le 30 septembre 2024]
Vous êtes historien et chercheur, qu’est-ce qui vous a incité à écrire ce livre d’intervention qui traite du débat public autour de Gaza ?
Le Proche-Orient n’est pas mon domaine de recherche. Je n’ai donc aucune compétence particulière pour analyser ou éclairer l’opinion au sujet de la situation actuelle. Sauf que dès le départ, cette guerre a été interprétée en mobilisant toute une série de concepts empruntés à l’histoire contemporaine ou bien qui ont un lien organique avec l’histoire de l’Europe qui, elle, est en revanche ma spécialité. On a par exemple tout de suite parlé de pogrom, on a fait un lien avec l’Holocauste, on a parlé de génocide, d’antisémitisme, de sionisme, de colonialisme… Je me suis senti interpellé par cet usage de concepts qui sont nés à partir de l’histoire de l’Europe
La crise de Gaza est le moment paroxystique d’une crise beaucoup plus ancienne, d’un conflit entre Israël avec le monde arabe en général et la Palestine en particulier. Mais c’est aussi un produit tardif de l’histoire du colonialisme et également de l’histoire juive en Europe, puis de sa transplantation dans le Proche-Orient. J’ai senti qu’il fallait réintroduire dans le débat quelques éléments de réflexion critiques sur l’usage de ces concepts qui appartiennent au départ à l’historiographie. Il fallait réfléchir la pertinence de ce lexique appliqué à la situation à Gaza et qui pose problème à bien des égards. Ce petit essai n’est donc pas une histoire de la guerre de Gaza, mais une réflexion sur la façon avec laquelle cette crise est pensée et interprétée. Et sur le langage qui est utilisé pour en parler.
La question palestinienne est depuis longtemps une question délicate et polarisante. Est-ce qu’il y a quelque chose qui a changé ces dernières années, singulièrement depuis les attaques du 7 octobre 2023 ?
Ce qui m’a frappé et qui me semblait même totalement impossible sous cette forme, c’est la réactivation spectaculaire et impressionnante depuis les attaques du 7 octobre d’un langage, d’un imaginaire, d’une vision du monde, d’une mentalité orientaliste. C’est-à-dire le retour à toute une série d’axiomes, de stéréotypes, de catégories que l’on pensait appartenir à la culture colonialiste et impérialiste du 19e siècle. Une vision dichotomique du monde dans laquelle il y aurait l’Occident comme l’incarnation de la vertu, de la démocratie, de la civilisation d’une part, et la barbarie à l’état pur d’autre part. La civilisation étant incarnée par Israël et la barbarie personnifiée non seulement par le Hamas, mais aussi plus largement par la Palestine.
Ça m’a impressionné parce que ce cliché d’une guerre non seulement justifiée, mais aussi nécessaire, pour défendre la civilisation contre la barbarie, cette idée de mission civilisatrice, reproposée au 21e siècle serait la risée de la planète entière si la situation n’était pas aussi tragique.
Cela marque l’avènement d’un monde occidental qui se retranche dans ses certitudes et dans ses dispositifs militaires, en pensant incarner à la fois le pouvoir et la morale, dans un monde qui est indigné par ce qui est en train de se dérouler à Gaza. Depuis, cette bulle, le monde occidental ne voit pas que la grande majorité de l’opinion de la planète est révoltée par ce génocide qui se déroule au vu et su de tous, pour ainsi dire en direct à la télévision. De même, il n’y a qu’en Europe et aux États-Unis qu’énoncer la situation d’apartheid en Cisjordanie semble poser problème. Elle relève de l’évidence pour les quatre cinquièmes de la planète.
Votre livre traite notamment de l’instrumentalisation de l’antisémitisme. Comment l’antisémitisme est-il devenu une arme visant à contrer toute critique d’Israël, de la colonisation ou des massacres de civils à Gaza ?
L’instrumentalisation de l’antisémitisme date déjà de plusieurs années, mais il a pris une ampleur nouvelle et absolument inédite dans les circonstances de cette guerre. Dès le lendemain des attaques du Hamas, un narratif s’est rapidement imposé suivant la formule conventionnelle suivante : « le 7 octobre est le plus grand pogrom de l’histoire après l’Holocauste ». Il a été repris par les grands médias et par de nombreux chef·fes d’État et de gouvernements.
C’est d’abord une distorsion complète de la notion même de « pogrom » puisque ce terme désigne au départ la violence organisée d’un régime politique contre une minorité opprimée, à savoir les Juifs dans l’empire des Tsars à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, juste avant la Révolution russe. Dire du 7 octobre qu’il est un pogrom est un retournement complet puisqu’ici, il s’est agi d’une violence organisée d’une minorité opprimée contre le régime qui la domine.
Ce narratif nous dit également sur le ton de l’évidence que le 7 octobre est l’épilogue de la longue histoire de l’antisémitisme. Avec ce récit, on instrumentalise l’antisémitisme pour évacuer l’oppression subie par les Palestinien·nes, une oppression systémique et planifiée de la part d’Israël. On efface d’emblée l’histoire de Gaza, comme le fait que depuis 2007 Gaza est un ghetto dans lequel sa population vit dans des conditions de ségrégation complète. Ou encore des données objectives très simples, mais fondamentales, comme le fait que l’armée israélienne avait par exemple déjà tué, avant le 7 octobre, 248 Palestinien·nes à Gaza au cours de l’année 2023.
Quels effets ce narratif peut-il avoir concernant la lutte contre l’antisémitisme ?
Je pense que les gens qui utilisent aujourd’hui à la légère ce genre d’accusation, et qui voudraient criminaliser toute opposition à la guerre, en la taxant d’antisémitisme, ne se rendent pas compte des conséquences à long terme de ce genre de pratique. Ça m’inquiète beaucoup eu égard de la possibilité même de lutter contre l’antisémitisme dans l’avenir.
Car si dénoncer un génocide devient une forme d’antisémitisme, une réaction possible est de penser que l’antisémitisme n’est pas si mauvais que ça, que l’antisémitisme a aussi quelques vertus s’il nous aide à lutter contre un génocide. Ou encore que si la mémoire de la Shoah sert à légitimer une guerre génocidaire, alors cela voudrait dire que la mémoire de la Shoah ne serait pas si vertueuse que cela et qu’il vaudrait peut-être mieux s’en passer. Dans une bonne partie du monde, cela incitera même des gens à se dire que l’Holocauste n’est qu’un mythe inventé pour légitimer l’existence de l’État d’Israël, pour cautionner sa politique, qu’il a été inventé pour défendre les intérêts d’Israël ou de « lobbys juifs ». Le résultat final de cette instrumentalisation de l’antisémitisme peut donc être la légitimation de l’antisémitisme lui-même ! Et potentiellement devenir une source pour donner une crédibilité au négationnisme.
Vous voulez dire qu’avec cette idée que « critiquer Israël ou défendre la cause palestinienne, c’est être antisémite », on a brouillé des repères qui structuraient le débat public en Europe depuis l’après-guerre ?
À l’heure où je vous parle, il y a encore des ministres, des chef·fes d’État ou de gouvernements occidentaux qui vont en Israël pour rencontrer les responsables de cette guerre et leur apporter leur soutien inconditionnel. Et dans le même temps, ceux qui critiquent ces postures ou ces initiatives – comme en France Jean-Luc Mélenchon — sont taxés d’antisémites. Le problème, ce n’est donc pas le soutien que nos gouvernements donnent à une guerre génocidaire – je rappelle que des institutions comme l’ONU reconnaissent qu’il y a un risque plausible de génocide –, mais le problème devient l’opposition à cette guerre !
Derrière tout ce dispositif narratif et parfois de propagande, avec des porte-paroles de l’armée israélienne sur les plateaux TV ou qui ont rédigé des reportages dans un journal comme le New York Times pourtant habituellement plus scrupuleux, il y a une idée qui apparait comme une évidence incontestable. À savoir une sorte d’innocence ontologique d’Israël : puisqu’Israël est l’État né sur les cendres de l’Holocauste, puisqu’Israël est la réponse du monde libre au totalitarisme, donc la politique d’Israël est par nature insoupçonnable de la moindre intention malfaisante. Ce qui fait que parler de génocide à propos d’Israël est obscène et blasphématoire. Il faut pourtant briser ce tabou parce qu’à long terme, encore une fois, ça risque non seulement d’emporter toutes légitimés d’Israël, mais ça risque aussi de décrédibiliser la cause de la lutte contre l’antisémitisme.
Ce dispositif discursif qui rend antisémite celui qui critique Israël en vue de délégitimer ses propos semble assez efficaces. Quels effets ont-ils dans notre capacité à mener un débat sérieux ou dans la manière de parler de la situation ? Est-ce que ça intimide ou provoque de l’autocensure ?
Aux États-Unis, un pays dans lequel le principe du free speech, c’est-à-dire de la liberté d’expression dans l’enseignement est sacré, cette campagne a réussi à déboulonner les présidents de plusieurs grandes universités — surtout des présidentes d’ailleurs parce que c’était toujours des femmes qui étaient visées. Ce qui suscite une attitude d’autocensure dans les milieux universitaires. Parce qu’il vaut mieux éviter de prendre une position claire au sujet de Gaza si on ne veut pas avoir d’ennuis ou risquer de voir les financements (privés) de son centre de recherche remis en cause. Il est important de souligner que, malgré cela, il y a eu une réaction très forte du monde académique sur la question de la guerre et du génocide à Gaza. Et beaucoup de chercheur·euses juifs·ves, souvent titulaires de chaire de Jewish studies ou de Genocide studies, ont ainsi pris des positions très fermes contre le génocide. Cette intimidation sous-jacente ne fonctionne donc pas toujours.
Au fil des pages de Gaza devant l’histoire, vous présentez le récit duquel il ne faut pas déroger pour être entendu dans les médias dominants : « l’occupation et la violence qui l’accompagnent doivent se comprendre comme l’autodéfense d’un État israélien menacé ; tandis que toute résistance palestinienne est, elle, à interpréter comme manifestation de haine antisémite ». Comment peut-on désamorcer ce récit qui rend malaisée la réflexion ?
Je pense que tout dépendra de l’ampleur du mouvement contre la guerre. À l’époque de la guerre du Vietnam, on était alors en pleine Guerre froide, il y avait une campagne de criminalisation du mouvement antiguerre très puissante. Ceux qui descendaient dans la rue et qui brûlaient le drapeau américain, qui refusaient de partir au Vietnam, étaient accusés d’être des totalitaires, d’être la cinquième colonne du communisme etc. Cette campagne de dénigrement était très forte. Et pourtant ce mouvement a pris une telle ampleur qu’il a fait plier l’establishment et le pouvoir de l’époque.
Je ne pense pas que la solution puisse venir de pressions pour que les responsables politiques ou les journalistes changent d’attitude. S’il y a un mouvement social très puissant, ils seront obligés de changer leur discours et de remettre en cause les mensonges qu’ils n’arrêtent pas de diffuser. C’est donc seulement si le mouvement devient massif que plus personne ne croira à l’idée selon laquelle Israël est en train de mener une guerre juste et nécessaire et que les Palestinien·nes sont animé·es par une haine indéracinable des Juifs·ves. Ce cliché sera remis en cause à partir du moment où ça sera sous les yeux de tout le monde, qu’il y a un mouvement contre la guerre, dans lequel se retrouvent toutes les composantes de la société. Encore une fois, il n’y a pas de recette, je pense que c’est tout simplement une question de rapport de force.
Enzo Traverso, Gaza devant l’histoire, Lux, 2024